INTERVIEW Un mémorial aux Roms victimes du nazisme vient d’être inauguré à Berlin. Des camps d’internement à l’extermination, Henriette Asséo, historienne des Tsiganes, dissèque une politique d’exclusion qui perdure.
Plus de soixante-cinq ans après le génocide, la chancelière allemande, Angela Merkel a inauguré un mémorial Sinti et Rom, mercredi à Berlin. Historienne à l’Ecole des hautes études en sciences sociales, Henriette Asséo travaille sur l’histoire du peuple tsigane en Europe. Elle est l’auteure des Tsiganes, une destinée européenne. Le film documentaire,Mémoires tsiganes, l’autre génocide, qu’elle a écrit avec Idit Bloch et Juliette Jourdan, vient d’être récompensé aux Rendez-vous de l’histoire à Blois. Elle explique ici toute la portée de cette inauguration et en profite pour mettre à mal quelques clichés.
Ce monument est-il le premier du genre ?
C’est le premier qui symbolise, à l’échelle de l’Allemagne, le caractère central des décisions et de l’exécution du génocide des Tsiganes par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Il consacre l’affirmation du caractère racial de la persécution que les autorités allemandes ont, pendant des décennies, refusé de reconnaître. En témoignent les obstacles qui ont jalonné, pendant dix-huit ans, sa construction par le sculpteur israélien Dani Karavan. L’artiste a été approché par Romani Rose, au nom des associations Sinti et Rom allemandes, puis le projet fut officialisé en 1999. Ce lieu de recueillement et d’hommage aux victimes est construit tout près du Reichstag et non loin du monument qui commémore la Shoah. Il est constitué d’un cercle, comme un trou sombre rempli d’eau qui reflète le ciel, le Reichstag et les visiteurs. Chaque jour à la même heure, un triangle de granit descend au fond et ramène à la surface une fleur sauvage.
Pourquoi l’édification a-t-elle été si longue ?
Les autorités de Berlin ont multiplié les difficultés financières ou administratives. Dani Karavan a dû mettre tout son poids et son prestige, non sans subir des attaques personnelles. Et le gouvernement fédéral a pris le projet en main. En fait, ces blocages étaient idéologiques. Il n’y avait pas de pression internationale exercée sur les autorités allemandes comme pour le génocide des juifs et celles-ci se sont très longtemps refusées à reconnaître celui des Tsiganes. Après la guerre, les rescapés tsiganes des camps n’ont pas pu récupérer leur nationalité allemande ni leurs biens. En 1954, un arrêt de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe avait affirmé que les Tsiganes zigeuneravaient été déportés comme « asociaux », et non pour des raisons raciales. Une idée partagée par l’écrasante majorité de l’opinion dans l’après-guerre.
Peu à peu, les choses ont commencé à changer quand des dirigeants juifs s’occupant des fonds de réparations comme l’URO, qui dépendait de l’ONU, ont pris la défense des Tsiganes. Puis, les associations Sinti et Rom ont pris le relais, aidées par les jeunes historiens des années 1970-1980 comme Michael Zimmermann. Ils obtiennent la reconnaissance en 1982.
L’extermination des Tsiganes a-t-elle été aussi radicale que celle des juifs ?
En Allemagne, elle a été encore plus totale car les Tsiganes n’ont pas eu la possibilité de s’exiler puisque les municipalités avaient créé de leur propre chef des zigeunerlager (camps d’internement pour Tsiganes) dès 1933 ! Dès le début, ils ont été pris au piège de la logique de la politique raciale qui est au cœur du nazisme.
Pour les nazis, l’exclusion des juifs est un préalable qui ne règle pas la question de la régénération interne de la race germanique. Se pose alors le débat de savoir qui mérite d’être véritablement « aryen ». Et ils se lancent dans une obsession de fichage généalogique. Dans cette logique, les Tsiganes indo-européens et aryens pouvaient être considérés comme les derniers représentants de la race perdue. Mais les experts nazis de la théorie de la race ont décrété que les Tsiganes allemands avaient perdu leur trace aryenne originelle en se métissant avec des Allemands de« basse valeur ».
Ce « métissage » menaçait la régénération voulue par Hitler. Si un seul des grands-parents avait été repéré comme tsigane, toute la famille était persécutée et exterminée. La population concernée était de 30 000 personnes pour l’Allemagne proprement dite, et de 90 000 en y intégrant les Tsiganes vivant sur le territoire du Grand Reich, c’est-à-dire aussi l’Autriche, la Bohême Moravie, une partie de la Pologne, les Pays-Bas et la Belgique, le Nord et le Pas-de-Calais, etc. Plus de 80% des familles tsiganes de ces régions ont été exterminées.
La persécution a commencé dès le début ?
A partir de 1935, elle est codifié dans le deuxième volet des lois de Nuremberg. En fait, elle débute dès 1933, sans même un ordre du régime, quand les municipalités procèdent systématiquement au repérage des familles de Tsiganes, ou de ceux qui vivent comme les Tsiganes, pour les enfermer dans des camps. Dès 1933, toutes les grandes villes se sont dotées d’un zigeunerlager fermé. En 1936, Himmler réorganise l’appareil de répression du régime. La Gestapo traque les opposants politiques et les juifs. La Kripo, la police criminelle, s’occupe de la répression sociale – la traque des asociaux -, mais aussi raciale non juive. Son chef Arthur Nebe organise le département spécial de recherche et de liquidation des Tsiganes.
Avec la guerre, Himmler et Nebe opèrent à l’échelle européenne. On estime que, sur une population d’un million de personnes en Europe, près de 500 000 Tsiganes ont été tués. Ce chiffre est revu à la hausse, comme celui de la population tsigane de l’époque, au fur et à mesure que les historiens épluchent les archives et prennent conscience de l’ampleur de la persécution. Nous arriverons à terme à une évaluation bien supérieure.
L’extermination des Tsiganes commence-t-elle en même temps que celle des juifs ?
C’est plus compliqué. Il vaut mieux la comparer à celle qui commence dès 1934, au sein de la population allemande, avec les Aktions T 4 de liquidation par euthanasie et stérilisation des « vies indignes d’être vécues ». Une décision de déportation à l’Est est prise en mai 1940 pour les Tsiganes de l’ouest de l’Allemagne. Ceux de Lackenbach, le plus grand camp d’Autriche, sont déportés au ghetto de Lodz. Il y a donc une association entre les deux entreprises d’extermination, mais avec une chronologie différente de celle des juifs. La persécution est très en amont mais la décision de la centralisation de l’extermination est, elle, en aval.
Quand commence l’extermination proprement dite des Tsiganes ?
La décision de centralisation des déportations familiales à Auschwitz est prise le 16 décembre 1942, sur ordre de Himmler qu’on appelle l’Auschwitz Erlass. Dans tout le Grand Reich, tous les Tsiganes et ceux qu’on qualifiait de Zigeuner-Mischlinge (issus d’unions mixtes avec d’autres Allemands) seront déportés dans un camp spécial, construit à l’intérieur de Birkenau, au cœur du centre de mise à mort des juifs. On y entasse 23 000 personnes dont 6 000 enfants. C’est aussi là qu’a eu lieu l’une des seules révoltes des déportés à Auschwitz. Le camp sera gazé dans la nuit du 2 août 1944.
Et à l’extérieur du Grand Reich ?
Les Tsiganes sont exterminés à 80-90% dans l’ensemble du Grand Reich. A l’extérieur, le chiffre varie de 40 à 80% selon les régions. A l’Est, la liquidation est systématique, comme pour les juifs. Surtout pour les kolkhozes soviétiques composés de Roms. Ces massacres systématiques de Tsiganes par les Einsatzgruppen et la Wehrmacht ont été longtemps sous-estimés, mais l’ouverture des archives permet d’en saisir l’ampleur. A l’Ouest, chaque pays occupé ou allié de l’Axe monte sa politique tsigane sui generis. Donc, ce n’est pas une politique d’extermination forcément systématique. Dans l’Etat croate oustachi, ils sont tous exterminés. En Italie, dès 1940, les Zingari sont internés. La Roumanie procède à la déportation des « nomades » vers la Transnistrie (région située entre l’Ukraine et la Moldavie).
Que s’est-il passé en France ?
Il faut remonter au début du XXe siècle où tous les Etats européens sans aucune exception mettent en place une politique tsigane, donc un enregistrement spécial de familles soit itinérantes, soit jugées par leur mode de vie ou par leurs caractères anthropologiques spécifiques. En France, la loi de 1912 instaure le « régime des nomades » qui enregistrait les familles exerçant un métier itinérant, qu’elles fussent ou non bohémiennes au sens anthropologique du terme.
En 1939, quand la guerre éclate, ces familles du régime des nomades sont assignées à résidence et, sur un ordre allemand d’octobre 1940 – donc très tôt -, l’administration territoriale constitue des camps d’internement spéciaux. On en compte une trentaine de « camps de nomades » en France, le plus connu étant celui de Montreuil-Bellay (Loiret), qui a concentré jusqu’à mille personnes. Ces familles (dont les membres sont à 60% des enfants) y vivent dans des conditions terribles, mais elles ne sont pas réclamées par les Allemands qui les considèrent comme des Français comme les autres.
Cependant, il y a eu des déportations individuelles de France et la surmortalité liée aux conditions des camps d’internement. Enfin, il y a surtout le cas spécifique du nord de la France et du Pas-de-Calais, qui relève de l’administration militaire belge et donc de l’Auschwitz Erlass, où toutes les familles tsiganes furent déportées à Auschwitz. En Alsace, ils connurent encore un autre régime : ils furent expulsés d’Alsace et du Palatinat avec les juifs vers la France qui les a internés au camp de Saliers en Camargue. La spécificité de la France est le choix d’une administration préfectorale qui passe, avec l’aide de la gendarmerie, d’un arrêté d’assignation à une décision d’internement en camps gérés par elle. Les internés ne sont sortis des camps qu’en 1946. Aussitôt après, on leur a imposé les carnets anthropométriques emblématiques du régime des nomades.
Sinti et Rom, le nom du mémorial a fait débat.
La bataille sémantique n’est toujours pas close. Après la guerre, les rescapés tentant d’obtenir réparation se sont trouvés dans les tribunaux face à leurs anciens persécuteurs convoqués par la cour comme« experts » sur les questions tsiganes. La qualification de tsigane était pour les nazis synonyme « d’asocial » et justifiait le refus devant des cours de justice des Länder. Il est devenu stigmatisant et les associations ont voulu le remplacer par une formulation anthropologique plus valorisante avec les termes de Sinti – Tsiganes vivant dans l’ouest de l’Europe – et Roms pour ceux de l’est.
Mais le problème actuel est dans l’usage exclusif du terme de Roms qui tend à s’imposer, faisant oublier les Sinti, les Gitans, les voyageurs… Il relève d’un imaginaire politique surdéterminé par la politique tsigane (Zigeuner Politik en Allemagne, régime des nomades en France).
Les termes de Rom ou de Tsigane recouvrent deux notions qui n’ont rien à voir. A partir de 1910, la question tsigane est fabriquée de toutes pièces par les Etats européens. Cette notion politique constitue un corps de doctrine, reconduit et réactivé régulièrement.
A l’heure actuelle, on assiste à la reconstitution d’une question rom qui succède à la question tsigane. Dans la langue cultivée du XIXe siècle, le mot tsigane recouvrait toute la diversité anthropologique et historique des communautés qui appartiennent aux nations européennes, depuis la constitution de ces nations à la fin du Moyen Age. La diversité des dénominations ne provenait pas d’une injonction extérieure, elle était l’expression de l’identité nationale des populations tsiganes de l’époque. Les Italiens se nommaient Zingari, les Allemands Zigeuner, les Français Bohémiens ou voyageurs, les Espagnols Gitanos et les Anglo-saxons Gypsies, etc.
Avec la revendication du terme rom, les leaders actuels de la cause romani ont été pris au piège de la constitution d’une identité transnationale qu’ils cherchent à imposer à tous, en gommant les identités nationales et régionales. Ils ne se rendent pas compte que la promotion d’une identité transnationale unique est utilisée contre eux, pour justifier l’internationalisation de la politique tsigane. Là où ils voyaient une forme d’émancipation en s’appuyant sur des institutions européennes, les Etats en profitaient pour reconstituer l’archétype du Rom migrant, apatride et incapable de s’assimiler.
Les Roms envisagés comme nationalité sans territoire sont donc une création artificielle ?
C’est une création politique qui, dans l’esprit des institutions européennes et des militants roms, devait permettre une émancipation locale des communautés romani de toute l’Europe. En fait, elle conforte la stigmatisation et la dénationalisation, non seulement des Roms migrants mais aussi des Tsiganes nationaux dans toutes leurs composantes d’héritages historiques pluriséculaires.
Et ils ne sont pas nomades ?
On confond là encore nomadisme et circulation ! Dans les sociétés anciennes, tout le monde bougeait, mais personne n’était nomade. On confond donc une réalité sociale avec l’imaginaire de la mobilité constitué en doctrine politique. Quatre-vingts pour cent des Tsiganes européens n’ont pas bougé de leurs pays respectifs depuis deux ou trois siècles. A l’Est, et dans l’empire austro-hongrois, il n’y avait pas de nomadisme. S’il y en avait eu, vous n’auriez pas de communautés qui constituent 8 à 10% des populations nationales. Cette histoire de nomadisme n’a aucun sens, et ce plus encore après quarante ans de communisme, car la mobilité était absolument bannie dans le monde communiste. Les Tsiganes ont pu être déplacés mais pas sédentarisés puisque la plupart d’entre eux l’étaient depuis toujours. Sous l’ancien régime, ils étaient attachés aux anciens domaines seigneuriaux. Le village tsigane homogène se trouvait à côté du village non tsigane. Beaucoup de Tsiganes portaient le patronyme du seigneur, c’est pour cela que des Karoly ou Sarkozy sont fréquents en Hongrie. Le seul élément qui les distingue est leur culture anthropologique, c’est une composante à part entière de la cartographie ethnique de l’Europe si multiple et qui a pratiquement disparu.
Et en Europe de l’Ouest ?
Non plus, il ne faut pas confondre nomadisme et itinérance économique. Gypsies, Bohémiens, Sinti piémontais ou Zigeuner des Etats allemands peuvent, bien sûr, appartenir au monde itinérant. Sous l’Ancien Régime, ils sont des militaires, donc itinérants comme toutes les armées de l’époque. Ils sont attachés à la noblesse locale. La culture sinti et gypsy est caractérisée par sa proximité avec l’aristocratie. L’intégration à la culture baroque s’est faite par la proximité militaire. Quand la mutation de ces sociétés de l’Ancien Régime a repoussé les guerres aux frontières, les armées se sont nationalisées ; du même coup, ces groupes tsiganes se sont ruralisés et initiés à l’exercice des métiers itinérants. Jusqu’en 1910, le commerce itinérant était dominant et pas seulement pour les Tsiganes. En 1930, 30% du commerce parisien était encore exercé par des marchands ambulants.
Alors pourquoi la reconnaissance du génocide tsigane n’est-elle pas intervenue plus tôt ?
Le tribunal de Nuremberg jugeait avant tout des crimes de guerre. Le rôle criminel de la Kripo n’a malheureusement pas été mis en lumière, parce que son chef, Arthur Nebe, qui avait pourtant initié les camions à gaz, n’était pas sur le banc des accusés. En juillet 1944, il avait participé à l’attentat raté contre Hitler. Aussitôt arrêté, il a été pendu. Il a glissé dans l’ombre portée de la résistance allemande. Cela explique l’occultation de son rôle dans l’extermination des Tsiganes.
Il y a un autre facteur qui tient à l’absence d’épuration de la biocratie nazie. Le procès des médecins criminels, qui pourtant glace le sang, a eu peu d’impact. Or, la politique raciale vis-à-vis des Tsiganes se forge au cœur même de l’appareil scientifique le plus prestigieux à l’institut Kaiser Wilhelm, ancêtre de l’institut Max Planck dont le directeur, Otmar von Verschuer, était intéressé prioritairement par ces questions. C’est lui qui propose à Josef Mengele d’aller à Auschwitz mener des expériences « scientifiques » pour compléter son post-doctorat. Verschuer continuera d’orienter la recherche génétique après-guerre, nombre de chercheurs ont été nobélisés. On peut parler d’une internationale scientiste prête à faire un black-out sur la question. Par ailleurs, on ne peut pas dire que la mémoire allemande des Aktions T 4 soit forte. Il est bien plus commode pour l’opinion de croire que les nazis ne liquidaient que des ennemis extérieurs.
Et où en est-on en France sur le sujet ?
A ce jour, pas une phrase de la part des présidents de la République successifs pour des concitoyens opprimés ! Les travaux historiques existent, ils ont montré que les familles internées étaient des victimes françaises du régime de Vichy. La cartographie des camps de nomades est faite. On peut citer la thèse des chercheurs Marie-Christine Hubert, Denis Peschanski, Emmanuel Filhol. Jacques Sigot a fait connaître le camp de Montreuil-Bellay. Le plus troublant, c’est qu’au moment où la reconnaissance mémorielle s’affirme, une politique tsigane se remet en place. Le 18 juillet 2010, Hubert Falco, alors ministre des Anciens combattants, reconnaît le rôle de l’administration française dans l’internement des nomades, les associations de Voyageurs participent à la cérémonie de commémoration des crimes de Vichy. Le même jour, l’Elysée lance l’offensive dite du discours de Grenoble !
Aujourd’hui, si vous êtes un Français vivant en habitat mobile, vous entrez, vous et vos enfants, dans le régime administratif séparé des gens du voyage. Cent ans après sa création, une brèche vient d’y être ouverte par le Conseil constitutionnel. La bataille ne concerne pas seulement la reconnaissance du passé mais la survivance de cette exception juridique française.
 SARTHE
SARTHE
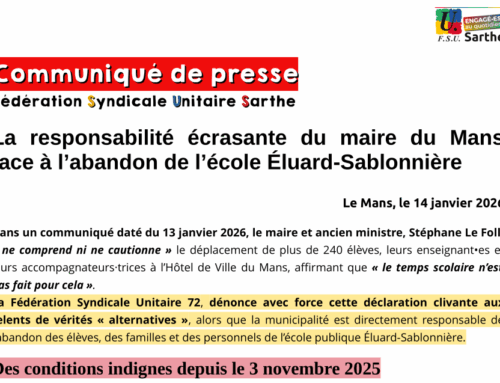
![Attaques au couteau : beaucoup de bruit, peu de moyens [mediapart]](https://fsu72.fsu.fr/wp-content/uploads/sites/39/2025/06/ARticle-mediapart-12-juin-2025-avec-titre-article-500x383.png)


