Quelques jours seulement après la publication du rapport PISA, l’opinion publique française est braquée sur les classes préparatoires. Elle semble avoir déjà oublié le principal enseignement de PISA : la forte montée des inégalités sociales de réussite scolaire. Cela augure mal de la mise en place de la nouvelle politique prioritaire que le gouvernement devrait annoncer en janvier.
Faut-il renoncer à la démocratisation de l’Ecole ? Certains pensent que tout a déjà été tenté. Ou que les dons seuls expliquent la réussite ou l’échec scolaire. Ce n’est pas l’avis de Jacques Bernardin. Maître formateur, chargé d’enseignement en IUFM, il préside le GFEN, un des principaux mouvements pédagogiques français. Dans un petit ouvrage il faut le point sur le rapport à l’école des élèves de milieux populaires.
Quels sens donnent-il à l’école ? Qu’est ce qu’apprendre pour eux ? Quel est leur rapport au savoir ? Jacques Bernardin s’appuie sur les recherches les plus récentes pour explorer ces nouveaux espaces. Avec l’idée que la démocratisation scolaire est possible. Son livre est autant un ouvrage théorique, qui présente les acquis des sciences de l’éducation, qu’une contribution tournée vers l’action.
Qu’est ce qui explique que l’échec scolaire soit plus important dans les milieux défavorisés et cela dès le plus jeune âge ?
A travers leurs expériences précoces et les interactions avec leurs proches, les enfants construisent un rapport à l’école et au savoir singulier. Celui-ci est souvent en écho avec l’expérience parentale en matière de scolarité et marqué par l’importance accordée à l’école, notamment pour l’accès à l’emploi. C’est avec cette grille de lecture que les enfants, devenus élèves, appréhendent l’univers scolaire.
Certains enfants retrouvent dès l’école maternelle un prolongement de ce qu’ils ont vécu et exercé depuis leur plus jeune âge dans leur espace socio-familial : une similitude de l’univers culturel de référence, l’habitude et l’encouragement à explorer l’environnement, une relation sereine aux adultes, l’immersion dans l’écrit et ses divers usages, une fréquentation précoce des livres, une pratique variée du langage, etc. Mais ce n’est pas le cas pour tous.
Faute de connivence avec les activités et les attendus de l’univers scolaire, les élèves de milieux défavorisés sont déstabilisés par les demandes qui leur sont adressées ou les interprètent de façon inappropriée, ce qui génère des difficultés d’apprentissage. Se cumulant, celles-ci alimentent le sentiment d’incapacité personnelle qui conduit au décrochage démonstratif ou silencieux, au rejet de ce qui les rejette et les humilie.
Construire un nouveau rapport au savoir pour ces enfants n’est-ce ce pas quelque part trahir leurs parents, leur classe ?
Les sociologues mais aussi des auteurs tels Annie Ernaux ont effectivement montré que réussir à l’école a un coût subjectif plus élevé pour qui s’émancipe du destin familial : c’est passer dans le clan de ceux qui savent et parlent bien, de ceux qui alors se positionnent du côté du pouvoir, avec le sentiment de trahison à l’égard du milieu dont on vient. Cela explique pourquoi certains auteurs ou universitaires disent « payer leur dette » par leurs travaux…
Ce sentiment de trahison est d’autant plus fort que la réussite scolaire est vécue comme exigeant une rupture avec les pratiques et les valeurs de son groupe d’appartenance, l’invalidation de l’image des proches, le reniement de ce qui est constitutif de l’identité sociale. Mais il n’y a pas de fatalité.
A contrario des critères habituels de sélection compétitive et d’individualisme forcené, la réussite scolaire peut s’élaborer en phase avec d’autres valeurs : répondre à l’exigence de donner sens à ce qu’on fait, avec des activités fonctionnelles et des savoirs construits en coopération avec les pairs comme réponses à des problèmes à résoudre, expérience forte et jubilatoire d’obstacles dépassés, de défis relevés, avec le sentiment de réussite partagée.
Réussir à l’école, ce n’est plus alors réussir contre mais avec les autres, élargir sa vision du monde sans perdre ses attaches, expérience de développement symbolique donnant à chacun le sentiment de grandir, de s’élever non pas en rupture mais en continuité avec son passé et les valeurs qui s’y attachent. C’est, par ce dépassement, contribuer à la fierté de ses parents.
Comment faire entrer ces jeunes dans la culture scolaire ?
Quel que soit leur âge, les élèves aspirent à agir pour comprendre l’ordre des choses. Il faut répondre à cette curiosité, l’alimenter et même l’élargir par une diversification des domaines d’activités : rien ne serait pire qu’une école aux ambitions rabougries sur des apprentissages dits fondamentaux, à l’exclusion des questionnements et investigations dans tous les autres domaines : sciences, technologie, histoire, géographie, arts, activités sportives, etc. Diversification qui alimente les questionnements et justifie le besoin d’y répondre, donc fait retour sur le besoin de lire pour s’informer, chercher, comprendre.
L’école, par le biais des activités et des images renvoyées par les adultes et les pairs, contribue à renforcer l’estime de soi. C’est en appui sur celle-ci que les sujets en construction développent leur envie de progresser. Encore faut-il créer les conditions pour que les élèves – tous les élèves – vivent des expériences de maîtrise, réussissent. Ce n’est pas dans la facilité mais à travers des défis, des situations exploratoires et des projets que cela se conquiert.
Elargir les expériences, multiplier les interactions : bien qu’indispensable, cela ne suffit pas pour initier à la culture scolaire. L’école est un lieu spécifiquement consacré à la compréhension de l’environnement physique et social, hors des urgences du réel et de la production, moins pour s’abstraire du monde que pour pouvoir le penser, mieux le comprendre et s’y préparer.
Comme cela n’est pas évident pour tous les élèves, il revient à l’école d’initier à ses usages, notamment à une posture réflexive sur les objets étudiés, qu’ils soient technologiques, conceptuels, artistiques ou langagiers. Entrer dans la culture scolaire, c’est prendre l’habitude de réfléchir avant d’agir pour analyser la situation, en cours d’activité pour pouvoir faire le point et la réguler, à terme pour tirer les fils quant à l’essentiel en jeu. Certains élèves y ont été familiarisés très tôt, d’autres beaucoup moins voire pas, et sont dans une logique où prévaut l’agir et la réalisation sur la réflexion. Or, c’est de la distance prise avec l’expérience qu’on peut en tirer leçon pour d’autres situations et contextes : c’est ce qui est gage de transfert des acquis et au-delà, développe l’autonomie intellectuelle.
Et dans celle de l’écrit ?
Dès l’école maternelle, la curiosité, l’envie de savoir peut être entretenue et développée grâce à la lecture de livres divers, narratifs et documentaires, mais aussi par l’exploration des écrits dans la pluralité de leurs fonctions. Explorer les formidables potentialités de cet outil, c’est étayer le projet d’apprendre. Mais c’est moins le « bain d’écrit » que la qualité des échanges visant à asseoir la compréhension qui compte, notamment celle des récits longs auxquels certains enfants ont été initiés très tôt et d’autres pas.
En matière de lecture, au cycle 2, l’accent mis sur l’apprentissage du code et la combinatoire peut occulter le temps consacré à la compréhension : comment, à partir de fragments, élaborer une signification cohérente et pertinente ? Cela est parfois laissé à discrétion de chacun. On sait alors qui en pâtit.
L’écriture, entendue comme production écrite, mérite d’être plus largement développée à tous niveaux. De la dictée à l’adulte à la production autonome, c’est un formidable outil permettant de nombreuses prises de conscience quant au fonctionnement du système écrit, facilitant la ressaisie de l’expérience, la prise de distance et la réflexion sur les objets travaillés. Trop peu d’élèves ont perçu cette fonction, restent sur l’idée que l’écriture relève du don, ne sert qu’à exprimer une pensée préformée. Ils sont souvent bloqués par la peur des fautes d’orthographe mais relisent peu leurs écrits et ont tendance à écrire « comme ils parlent ».
Finalement, ce qui fait problème, c’est la gestion de la situation langagière écrite : comment faire avec et malgré l’absence de l’autre ? Comment recréer un univers non partagé par les interlocuteurs ? Là encore, la précocité et la fréquence des expériences comptent. Il revient à l’école de familiariser tous les élèves aux stratégies de lecture permettant d’élaborer la compréhension, aux débats littéraires et aux relectures distanciées en matière d’écriture.
Les pratiques enseignantes participent-elles de la construction des inégalités sociales scolaires de réussite ?
Les travaux de recherche rejoignent des constats dressés par l’Inspection générale à ce sujet. Certaines adaptations pédagogiques semblent moins propices que d’autres à enrayer la ségrégation scolaire. Ainsi par exemple, lorsque sur la base des difficultés rencontrées par les élèves, on simplifie ou segmente les tâches à l’excès, au risque d’affadir les exigences et de perdre l’unité de l’activité. Le travail ainsi mené « au pas à pas » peut tromper les élèves quant à son enjeu, les amener à privilégier la réalisation au détriment de la compréhension. Quant à l’aide individuelle, elle est à double tranchant. Si elle permet un premier engagement et évite le décrochage de l’élève, elle renforce conjointement sa dépendance à l’égard de l’expert, sa tendance à la passivité et à l’attentisme. Toutes ces modalités adaptatives contribuent, à l’insu des acteurs, à renforcer les écarts entre les élèves alors même qu’on cherche à les réduire.
Dans d’autres classes, c’est l’aveuglement à l’égard des différences qui pose problème, le sentiment d’évidence des situations scolaires et de leurs visées. Faute d’être avertis du rapport au savoir des élèves et de ce qui peut faire obstacle à leur compréhension, certains enseignants lancent l’activité sans précaution, au risque de malentendus quant à son interprétation. N’ayant pas écouté ou pas bien compris, les élèves ne cessent de redemander la consigne ou de solliciter l’enseignant pour qu’il avalise ce qu’ils ont commencé, comme dans l’impossibilité de pouvoir réguler eux-mêmes leur travail. D’autres demandent à leurs voisins ou les imitent, mais sans clarté des finalités. Et pour réguler, quand les interactions individuelles prennent le pas sur le moment de reprise collective, non seulement les appuis ne sont pas de même nature, mais certains élèves peuvent imaginer que l’essentiel est fait quand la réalisation est arrivée à son terme : cela pourrait expliquer qu’ils négligent le temps de « correction ». D’autant plus quand la reprise réflexive est trop fugace, menée à la sauvette par l’enseignant faute de temps. Tout confirme alors, aux yeux des élèves, qu’apprendre se résume à « faire ce qu’on nous demande »…
Comment y remédier ?
Redonner sens à l’école et aux savoirs exige de repenser les situations d’apprentissages autour de leurs enjeux : quels concepts clés derrière ce titre ? Quels déplacements cognitifs cette notion exige-t-elle de la part des élèves ? Quelles sont leurs modes opératoires habituels dans cette activité ? La préparation consiste à mettre en scène les points forts autour desquels le questionnement et la recherche des élèves va s’organiser, comme les étapes de l’élaboration. Il faut accorder le temps de comprendre. Rien ne sert d’exercer sur du sable…
La conduite de classe doit viser l’implication optimale des élèves. Un temps de recherche individuelle suffisant est indispensable avant d’organiser la confrontation entre pairs : temps de l’explicitation, de l’argumentation, de l’étayage par la preuve. La montée en généralisation est essentielle. Ce n’est pas le plus facile à mener, mais le plus formateur pour les élèves : il s’agit alors de construire les conditions de leur émancipation intellectuelle.
Propos recueillis par François Jarraud
Jacques Bernardin, Le rapport à l’école des élèves de milieux populaires, de Boeck, ISBN 9 782804 182243
 SARTHE
SARTHE
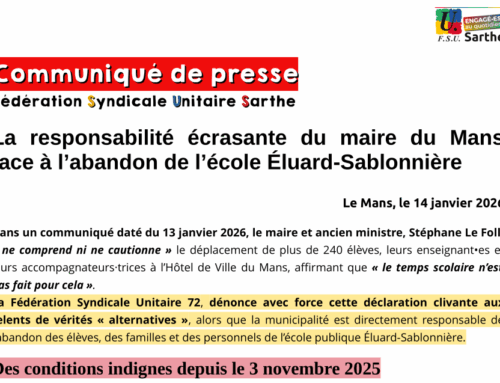
![Attaques au couteau : beaucoup de bruit, peu de moyens [mediapart]](https://fsu72.fsu.fr/wp-content/uploads/sites/39/2025/06/ARticle-mediapart-12-juin-2025-avec-titre-article-500x383.png)


