<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
J’ai tenu à donner comme titre à mon exposé « École maternelle, école première ». D’abord, parce qu’au risque de vous choquer et malgré tout le respect que j’ai pour Pauline Kergomard, je crois que l’expression « école maternelle » est obsolète. Je la crois liée à une époque révolue où l’éducation de la petite enfance relevait exclusivement des femmes et, en particulier, des mères. De plus, je crois la formule génératrice de malentendus : elle laisse penser que cette école prolonge simplement l’action de la famille et reste dominée par la gestion des affects. Pour certains même, la notion d’école maternelle renvoie à une sorte de modèle intermédiaire : elle ne serait pas une école de plein exercice, mais une sorte de structure intermédiaire, vouée à rester dans le « pré » : pré-apprentissage, pré-scolaire, pré-social… Or, je crois qu’il faut revendiquer pour l’école maternelle française un statut de véritable école, et même un statut d’école fondatrice de la scolarité. C’est pourquoi je propose de l’appeler « école première » et je vous suggère de relayer massivement cette demande… « École première » cela signifie que c’est, chronologiquement, la première des écoles, mais aussi que c’est premièrement une école et une école essentielle pour la réussite de la scolarité de l’enfant ainsi que pour la construction d’une société démocratique plus juste et plus solidaire.
Pour illustrer cette proposition, je voudrais faire quatre séries de remarques autour de quatre enjeux fondamentaux. D’abord, je m’intéresserai à l’école maternelle comme cadre institutionnel permettant d’articuler la continuité et la rupture qui structurent toute véritable éducation. Ensuite, j’évoquerai l’école maternelle comme lieu d’une activité pédagogique capable de dialectiser le développement et les apprentissages. Ensuite, je travaillerai sur l’interaction, fondamentale à l’école maternelle, entre le vivre ensemble et les apprentissages cognitifs. Et, enfin, j’insisterai sur ce qui me tient particulièrement à coeur aujourd’hui : l’école maternelle comme lieu de l’émergence d’un enfant-sujet, contre toutes les tentations de réduction de l’enfant à un objet.
-o0o-
L’école maternelle : continuité et rupture
Le philosophe Alain a brillamment stigmatisé une école trop affective : il affirmait avec force que l’école devait rompre avec l’univers familial, se centrer sur des exercices et des savoirs qui échappent au relativisme des cultures familiales, apporter à l’enfant une indifférence salutaire, construire un climat qui permette l’exercice serein de la raison universelle. On peut, bien sûr, trouver les formules excessives et peu accordées à notre sensibilité contemporaine. Il y a néanmoins, dans les propos d’Alain, quelque chose de rigoureusement exact et encore parfaitement d’actualité. L’école n’est pas la famille : c’est une institution qui a pour vocation de transcender les histoires singulières et les affinités électives. L’école n’est pas une « communauté », au sens où elle réunirait des personnes reliées entre elles par des forces centripètes, partageant des goûts, des convictions idéologiques ou religieuses, se choisissant pour faire ensemble une expérience de vie collective. L’école est une société où l’on apprend à vivre et à travailler ensemble indépendamment de nos affinités. Comprenons nous bien : les communautés ont évidemment droit à l’existence. Nous ne pourrions pas vivre sans ancrage communautaire. Mais une société requiert aussi des espaces où les personnes travaillent ensemble, respectent leurs différences, renoncent à envahir l’espace public de leurs préoccupations privées et tentent de construire et respecter des règles qui relèvent de l’intérêt collectif. À cet égard qu’il existe des communautés dans la société est parfaitement normal, que l’école soit fondée sur un modèle communautaire est totalement contraire à l’idéal républicain.
C’est pourquoi une des premières vertus de l’école, c’est l’aléatoire de la composition des classes : une classe est un ensemble de gens qui ne se choisissent pas. Et il est bon qu’ils ne se choisissent pas ; il est bon de faire de l’aléatoire vertu – dans les classes comme dans les jurys d’assises de la République – car l’aléatoire est ici l’expression même du projet républicain et de l’ambition démocratique : fabriquer du collectif en dépassant les affinités psychologiques, sociologiques et idéologiques. Il nous faut insister sur ce point parce qu’on dit et montre trop, un peu partout, une école maternelle centrée sur l’affect où il s’agirait d’abord d’être bien ensemble. Certes, il ne faut pas inverser les choses : il ne s’agit pas d’être mal ensemble ni, a fortiori, de cultiver les conflits ! Mais le projet de l’école française &
#8211; y compris de l’école maternelle en tant qu’elle en est une composante essentielle – n’est pas d’être d’abord que les enfants y soient « bien ensemble » : l’important, c’est qu’ils se retrouvent dans un espace public où ils parviennent à vivre ensemble pour apprendre ensemble… ce qui n’est pas tout à fait la même chose.
À cet égard, l’école maternelle est à une place décisive et joue un rôle absolument fondamental. Elle fait rupture avec la communauté familiale ou sociale. Et, pour que cette rupture soit acceptée et constructive, elle doit en faire un objet de travail, l’inscrire dans une trajectoire, permettre qu’elle ne soit pas vécue comme une violence, un arrachement prématuré, une trahison… mais bien comme un moyen de se développer, de découvrir de nouveaux modes de fonctionnement et de nouveaux horizons… qui permettront de revenir plus riche et, progressivement, de plus en plus libre dans l’espace communautaire, familial et social.
C’est pourquoi l’école maternelle reconnaît l’élève comme « un enfant de la famille », mais le traite comme « un enfant de la société ». Et, surtout, elle gère ce passage, construit cette transition et fait en sorte que chaque élève la vive au mieux. Pour cela, il lui faut accueillir chaque enfant tel qu’il est, sans le contraindre à abdiquer son identité, mais en l’aidant à accepter les règles qu’un collectif doté d’un projet propre (ici « apprendre en commun ») doit imposer à chacun de ses membres. Il y a bien une rupture, mais elle n’est possible – et c’est le paradoxe de toute rupture – que si elle s’inscrit dans une continuité : sans continuité, la rupture devient normalisation externe, imposition d’une abdication de soi qui provoque, immanquablement, un sentiment de persécution et un repliement identitaire.
Le pédagogue, jadis, accompagnait l’enfant chez le précepteur, hors de l’enclos familial. Accompagner, tout est là : passer d’un monde à un autre, faire le chemin qui conduit vers l’altérité, aider à la séparation, exorciser les peurs, faciliter le travail de deuil d’un être qui, souvent douloureusement, découvre que, non seulement, il n’est pas au centre du nid, mais que son nid n’est pas au centre du monde. Ainsi, la rupture n’est possible qu’articulée à une continuité, car le développement de l’enfant n’est pas une succession de métamorphoses miraculeuses décrétées par les adultes, mais une interaction complexe, dans la temporalité, entre un sujet et un contexte, une personne singulière et des expériences nouvelles, un enfant et des apprentissages. C’est l’enfant concret, tel qu’il nous arrive, qui apprend et ce sont les apprentissages qui le transforment. Son identité se construit dans un rapport à l’altérité que l’éducation doit accompagner pour qu’il ne suscite ni repliement, ni rejet. Par définition, on n’apprend que de l’autre : quand on accepte de se laisser « altérer » par lui, de confronter ce qu’on pense à ce qu’il dit, ce que nous sommes à ce qu’il est. Et l’ « altération » n’est possible que si l’on reste suffisamment soi-même pour ne pas craindre d’être anéanti par l’interlocution d’autrui, et qu’on s’ouvre suffisamment à lui pour entendre ce qu’il peut nous apporter.
En réalité, la découverte de l’altérité est au coeur du processus éducatif. Apprendre, c’est se laisser prendre par et dans l’altérité. C’est découvrir et accepter qu’il existe des êtres qui appartiennent à d’autres familles, mais aussi à d’autres quartiers, à d’autres communes, à d’autres pays. Que ces êtres peuvent ne pas vivre comme nous, ne pas parler comme nous, ne pas penser comme nous… tout en partageant avec nous « l’humaine condition ». Apprendre, c’est entendre d’autres langues, des langues qu’on ne comprend pas immédiatement mais dont on tente progressivement de percer le mystère : langues étrangères, langue de l’abstraction mathématique, langue de la création artistique, langues élaborées par les hommes tout au long de leur histoire. Apprendre, c’est agrandir progressivement le cercle de sa pensée, y intégrer des éléments nouveaux, de plus en plus éloignés de nos préoccupations immédiates, mais qui, précisément, permettent, au fur et à mesure, de se comprendre et de comprendre le monde… Tout le courant de « l’Éducation nouvelle », de Claparède à Cousinet, de Wallon à Piaget, malgré des différences majeures en soin sein sur bien des points, se retrouve pour affirmer l’importance, à la fois psychosociale, cognitive et citoyenne, de cette démarche. C’est le même mouvement qui est à l’œuvre dans le travail de décentration du petit enfant qui tente de comprendre ce qui pousse un camarade à agir autrement que lui, dans l’investigation scientifique qui s’efforce de créer des modèles originaux capables d’intégrer des éléments nouveaux et dans la délibération démocratique qui tente de dépasser la juxtaposition des intérêts individuels pour définir ce qui pourrait relever du « bien commun ».
Ainsi voyons-nous à quel point l’école maternelle est une « école première », et, même plus, une « école princeps », matricielle en quelque sorte, au regard des objectifs et de la mission de notre institution scolaire. Elle travaille sur l’articulation fondatrice du développement personnel, social et politique. Et elle travaille au plus près, au plus concret, au plus vif…
Pour préciser cela, et au risque d’être moqué par quelques-uns des esprits forts qui légifèrent sur l’École, on pourrait montrer que rien n’est plus décisif en éducation – et pas seulement symboliquement – que d’agir avec discernement sur des questions aussi triviales en apparence que la tétine et le doudou ! Vous savez bien, en effet, l’importance de rompre, à l’école, avec l’usage de la tétine : même si elle peut, un temps, permettre d’assurer la continuité entre la famille et l’école, elle contribue au repli de l’enfant sur lui-même, empêche la communication et interdit finalement d’accéder au langage, à tous les langages. La tétine, c’est ce qui empêche d’entrer en relation avec l’autre, ramène en permanence au plaisir buccal et enferme dans la jouissance narcissique orale… On ne peut pas, pour autant, arracher la tétine violemment ; mais il faut apprendre progressivement à s’en passer. Et, voilà qui est justement un vrai travail de professionnel ! Quand on voit le nombre d’adolescents et d’adultes qui restent attachés à des tétines symboliques – prothèses technologiques ou substances chimiques –, on ne peut que regretter la manière dont on tourne en dér
ision aujourd’hui le travail des enseignants et enseignantes d’école maternelle ! Il faudrait, tout au contraire, montrer à quel point il est décisif… en particulier quand il permet de passer de la tétine au doudou. Car, si le doudou est un objet personnel que l’on apporte de chez soi, il est différencié par rapport à son propre corps : c’est quelque chose que l’on peut montrer, dont on peut parler et dont on va apprendre à se détacher sans l’abandonner complètement. Le doudou médiatise quand la tétine isole… Et puis, bien sûr, au-delà de ces éléments structurants, il y a tout le travail que fait l’école maternelle sur le rapport famille / école : apporter quelque chose de la maison et rapporter quelque chose à la maison, échanger, dans chacun des lieux, à propos de ce que l’on apporte, distinguer ce qu’on peut apporter de ce qui ne doit pas l’être. Tout cela permet de faire dialoguer et de distinguer l’espace privé et l’espace public : or, voilà justement un comportement essentiel dont on déplore qu’il ne soit pas stabilisé au collège… tout en ridiculisant ceux et celles qui, en maternelle, s’efforcent d’en montrer l’importance.
Enfin, on ne saurait trop insister sur l’ensemble des apprentissages qui, en maternelle, doivent permettre à l’enfant, devenu élève, de trouver progressivement la bonne distance par rapport à l’univers familial : construire la capacité à expliquer, à argumenter, à montrer ce qu’il est parvenu à faire tout seul sans, pour autant, renier ceux qu’il aime… voilà qui est absolument fondamental. Accéder à l’objectalité de connaissances qui ne relèvent pas d’une transaction affective mais d’une exigence de précision, de justesse, de vérité… voilà qui est profondément émancipateur. L’école, en permettant cela, ne fomente pas une agressivité systématique de l’enfant envers sa famille, bien au contraire : elle libère l’affectivité de ses obligations normalisatrices. Elle permet aussi à l’enfant de ne pas être réduit à son appartenance familiale et de pouvoir exister ailleurs, pour se mettre en jeu, se mettre en je.
Vous voyez à quel point l’école maternelle est une école « première ». Elle incarne au plus haut point le projet d’une éducation dialectique, articulant continuité et rupture, permettant aux élèves de s’assumer, dans leurs moindres gestes, comme des êtres, à la fois enracinés et émancipés. L’enjeu est considérable : des êtres sans racines cherchent désespérément leur origine et basculent souvent dans la violence et les transgressions, des êtres sans émancipation deviennent facilement la proie de toutes les pressions et de tous les fanatismes.
-o0o-
L’école maternelle au cœur de la dialectique entre développement et apprentissages
Je ne vais pas reprendre ici, bien évidemment, le débat entre Vigotsky et Piaget sur les rapports entre le développement et les apprentissages : c’est une question complexe. Mais je voudrais simplement rappeler à quel point la situation actuelle est préoccupante et caricaturale dans ce domaine ! Peut-être avons-nous trop insisté ces dernières années, dans les discours pédagogiques, sur le développement et son caractère endogamique. Sans doute avons-nous un peu abusé des métaphores horticoles de l’épanouissement, de la graine et du jardinier… Il faudrait, pour comprendre le sens et la portée de ces propos, mener une analyse épistémologique fine des textes, distinguer ce qui renvoie à des référents théoriques de ce qui représente une forme de rappel polémique, montrer que la fonction du discours « spontanéiste » est de réguler le discours volontariste en rappelant l’irréductibilité de la croissance de l’enfant par rapport aux actions que l’on exerce sur lui, dégager les contradictions constructives qui ouvrent des espaces à l’inventivité didactique… bref, regarder les discours et les pratiques avec un peu de rigueur ! Mais la période n’est pas propice à cela et l’on préfère isoler quelques formules, les dégager de leurs contextes, les monter en épingle afin de discréditer un travail de longue haleine, jeter le doute sur une institution et semer le soupçon sur une profession.
En réalité, quiconque a l’honnêteté d’étudier de près la pédagogie de l’école maternelle telle qu’elle s’est développée depuis un demi-siècle, ne peut que constater la montée en puissance d’un travail de plus en plus exigeant sur les apprentissages. Mais ce travail s’est effectué en tension permanente avec une attention au développement de la personne dans toutes ses dimensions comme dans sa globalité. Or, ce qui nous est proposé aujourd’hui est une fausse symétrie : on s’appuie sur la dénonciation d’un « spontanéisme » qui n’a jamais vraiment existé pour développer une conception technocratique où les apprentissages, largement réduits au domaine cognitif et aux mécanismes opératoires, sont déconnectés de toute préoccupation développementale. Inspiré d’une certaine vision des neurosciences, ce courant de pensée développe – à l’inverse des métaphores horticoles – la vision traditionnelle de « l’homme machine », relookée en « enfant-computeur ». Avec les oripeaux d’une modernité scientiste, elle évacue la complexité des recherches sur lesquelles nous travaillons depuis longtemps. Elle se pare même d’une certaine « objectivité universitaire » pour séduire une opinion publique rétive aux nécessaires nuances et interrogations des problématiques éducatives.
Ainsi, malgré quelques correctifs et une introduction bienveillante, les programmes de l’école primaire de 2008 sont-ils, pour l’essentiel, un ensemble d’objectifs d’apprentissages techniques séparés les uns des autres, identifiables et évaluables indépendamment de tout projet de développement global que l’on pourrait avoir pour l’enfant. En invoquant « la liberté pédagogique », on s’exonère de vision éducative, de propositions capables de donner sens à tous les apprentissages, de les relier dans une visée émancipatrice. La réduction aux « fondamentaux » devient, en réalité, une résignation à la juxtaposition, une évacuation du « fondamental ».
Cette démarche, outre son caractère intellectuellement discutable, est pédagogiquement très dangereuse pour toute une série de raisons. D’abord
, elle permet de transformer l’enseignant en « prestataire de services » : que la société – et ses lobbys les plus efficaces – exige, par l’entremise du ministère, que l’on ajoute des apprentissages nouveaux et que l’on retranche des anciens, les professeurs n’ont qu’à s’exécuter. Ils ne sont que des courroies de transmission des demandes sociales et doivent renoncer – contre la tradition républicaine dans ce qu’elle a de meilleur – à une action éducative cohérente ordonnée à l’exigence des Lumières : « Ose penser par toi-même. »… D’autre part, ce programme-catalogue privilégie, évidemment, les objectifs les plus valorisés socialement, mais sans identifier les médiations qui permettent de les atteindre : nul ne conteste qu’il faut que les enfants sachent lire, écrire, compter, accéder à l’intelligence de notre histoire et de la science. Mais il y a une immense différence entre le fait d’imposer ces objectifs comme pédagogiquement prioritaires et le fait d’en faire des objectifs chronologiquement et didactiquement premiers. Les pédagogues savent que, si l’on coupe les ponts, peu d’enfants sauront et pourront sauter l’obstacle… Par ailleurs, et dans cette perspective, on réduit les apprentissages à ce que l’institution veut et sait évaluer, c’est-à-dire – malheureusement – à ce qu’elle peut quantifier. Passent ainsi à la trappe des domaines essentiels qui contribuent au développement de l’enfant, tant dans le champ psychomoteur que dans celui de la sensibilité, dans le registre culturel ou le champ social… À l’horizon, ce qui se profile, c’est un enseignement réduit à un ensemble de savoir-faire mesurés par des tests « en temps réel » dont les résultats permettront aux usagers de développer des stratégies de consommation en examinant le meilleur rapport qualité / prix. Les parents eux-mêmes seront aspirés – beaucoup le sont déjà – par une logique purement comptable : on les rendra insensibles, voire réfractaires, à la dimension éducative de l’école, n’exigeant que des résultats immédiats en « espèces sonnantes et trébuchantes ». eux-mêmes et toute la société seront perdants, bien sûr. Les plus modestes seront, eux, complètement floués, ignorant que la réussite sociale se joue aussi dans un « ailleurs culturel » auxquels ils ne peuvent initier leurs enfants et que l’école aura déserté.
Pour justifier tout cela, les « théoriciens » d’aujourd’hui reprennent de vieilles antiennes éculées et dont on croyait s’être définitivement débarrassé. Ainsi Luc Ferry, imité, dans ce domaine, par ses successeurs, a-t-il longuement développé l’opposition entre le jeu et le travail, la motivation et l’effort. Il reproche aux pédagogues de subordonner toute activité d’apprentissage vraiment formatrice à une démarche volontaire de l’enfant, d’articuler démagogiquement les savoirs à des jeux séduisants ou à des intérêts superficiels. Contre de telles tentations, il faudrait réhabiliter les exercices formels et l’effort systématique : le travail d’abord, ingrat et laborieux… les satisfactions ensuite, au terme de longs cheminements imposés par l’adulte. Dans ce cadre, la motivation n’est pas nécessaire pour engager des apprentissages ; elle est même impossible tant que l’on n’a pas été forcé à découvrir un domaine de l’intérieur ; elle ne vient qu’après que le maître ait contraint l’élève à se plonger dans des savoirs et à en acquérir mécaniquement les « bases »… On sourit, bien sûr, devant de telles confusions : outre le fait que cette « théorie » ignore les apports d’hommes aussi différents que Dewey et Wallon, qu’elle écarte aussi bien l’idée de « pédagogie fonctionnelle » développée par Claparède que celle de « didactique anthropologique » apportée par Chevallard, elle identifie, avec une mauvaise foi confondante, « motivation » et « mobilisation » : car les pédagogues ne disent pas qu’il faut que les exercices soient systématiquement greffés à des motivations préalables, ils disent que, pour qu’ils soient efficaces, il faut que les élèves se mobilisent dessus… et ils affirment, justement, que cette mobilisation n’est pas spontanée, mais qu’il revient à l’enseignant de la faire exister.
En réalité, la ligne de fracture idéologique majeure aujourd’hui est là : en face de nous, nous avons des « intellectuels » et des décideurs pour lesquels le dressage est un préalable à l’éducation. Pour eux, il faut d’abord mettre en place des automatismes et que ce n’est qu’après à un moment dont on ne sait pas très bien quand il va advenir, que l’on prendra en compte la personne dans sa complexité. « Travaillez, faîtes des efforts… vous finirez peut-être par être motivés un jour et, à ce moment-là, vous entrerez dans une nouvelle phase, beaucoup plus autonome, de votre développement. »… « Répétez et récitez sans vous poser de questions ! Un jour viendra où vous pourrez, sans doute, vous intéresser à ce que vous dites. »… C’est ainsi qu’on stigmatise le jeu – identifié sottement à la facilité –, sans voir en quoi il est un moyen de construction du symbolique, d’apprentissage de la prise de rôle, de travail sur l’occupation de l’espace et du temps… Travail pourtant infiniment nécessaire au moment où, par ailleurs, « l’enfant du désir » est encouragé à vampiriser son entourage, à n’exister que dans l’immédiateté de la pulsion, à vouloir tout, tout de suite, à ne jamais surseoir à ses impulsions. En réalité, il n’y a pas, d’un côté, le jeu qui serait « distrayant » et, de l’autre, les dispositifs d’apprentissage qui seraient « austères ». Il y a, d’un côté, des fonctionnements pulsionnels, répétitifs et narcissiques et, de l’autre, des cadres institués qui permettent l’émergence d’une réflexion : ces cadres peuvent emprunter aux jeux et fonctionner comme des dispositifs d’apprentissage, nous en connaissons tous de nombreux exemples… On s’en veut de devoir rappeler de telles banalités si connues, mais il faut le faire, surtout quand, derrière la condamnation du jeu, c’est l’ensemble des pratiques pédagogiques de l’école maternelle qui est visé.
Soulignons, enfin, que la caricature de psychologie de l’enfant qu’on nous sert aujourd’hui – en lieu et place d’une véritable réflexion pédagogique – est parfaitement en cohérence avec la montée plus globale du paradigme de « l’homme machine » et du « corps médicalisé ». Ce qui se profile à terme, c’est la disparition de toute « prévention éducative » au profit d’activités linéaires qui, en cas de dysfonctionnements ponctuels, font appel systématiquement à des remédiations tout aussi ponctuelles. C’est l’h
égémonie du paradigme médical traditionnel – remis en cause aujourd’hui, par la médecine elle-même – et qui fonctionne sur la sempiternelle trilogie : symptôme / diagnostic / remédiation. On pointe, avec une obstination sans faille, les incidents et les accidents d’un parcours conçu comme une course d’obstacles sur le modèle béhavioriste, et l’on « intervient », le plus tôt possible et sur le modèle de la radiothérapie, en tentant de détruire les cellules malignes, sans s’intéresser à l’équilibre plus global de l’enfant. Dans ces conditions, on s’interdit, à la fois, la compréhension de la complexité développementale et l’inventivité éducative. On fonctionne sur le principe de la monofactorialité, alors que tous les chercheurs s’accordent à reconnaître la polyfactorialité des troubles d’apprentissage aussi bien que de la conduite. On récuse toute ce qui ne se présente pas comme une « solution » immédiate et ciblée à un problème isolé, alors que, justement, le développement suppose un ensemble de conditions qui interagissent entre elles et contribuent à constituer ou reconstituer des équilibres. Enfin, on s’interdit de penser l’éducation en termes de politique de prévention. C’est dire, en fait, qu’on s’interdit de penser l’éducation tout court.
Quelques exemples pour illustrer la montée de ce paradigme anti-éducatif… Qu’on regarde la manière dont a été traitée la question du samedi matin : on a répondu à une question sociale, certes bien réelle (les parents séparés et les problèmes de garde), mais sans considérer, en même temps, d’autres questions tout aussi décisives, comme la rythmicité veille / sommeil, l’alourdissement inévitable de journées scolaires déjà très fatigantes, la nécessité de trouver des plages de temps pour faciliter les relations entre les parents et l’école, etc… Et, que penser d’une politique qui prétend lutter contre l’échec scolaire sans jamais aborder la question essentielle de la montée de la fatigue chez les enfants ? On sait bien que cette fatigue est due, entre autres, à la dérégulation de la télévision qui reste à l’abri de toute interrogation sur ses horaires de diffusion – avec un démarrage de plus en plus tardif de ses prime time –, sur les contenus de ses programmes à destination de la jeunesse, sur la diffusion de dessins animés le matin, avant les classes, etc. Nul ne s’émeut, d’ailleurs, quand les chaînes privées qui cherchent à capter le public enfantin le matin décident de supprimer les génériques de fin d’émissions afin de mieux scotcher les enfants au poste et d’éviter qu’ils ne zappent pour rejoindre une autre chaîne, échappant ainsi à la publicité… Tout le monde s’accorde pour décrire aujourd’hui nos élèves comme surexcités, trop fatigués pour pouvoir se réveiller autrement qu’en sécrétant de l’adrénaline, manquant d’attention et de concentration. Mais nul ne songe à interroger « l’écologie médiatique » qui les entoure. Il faut espérer qu’on se réveillera plus vite sur cette question que sur celle du réchauffement climatique ! Avant que les dégâts ne soient irrémédiables…
Or, loin de soumettre ces questions à une réflexion collective en profondeur, on les traite en catimini par des dispositifs de compensation et de contention. Ainsi voit-on se développer à grande vitesse le dépistage des TDAH (troubles de déficit de l’attention et de l’hyperactivité). À partir des tests nord-américains de Conners et Tremblay, on identifie des dysfonctionnements qu’on traite avec de la Ritaline© ou du Concerta©. Il n’est pas question de nier que, dans certains cas, ces prescriptions puissent être utiles, mais ce qui est en jeu ici, c’est leur caractère systématique : face à un enfant turbulent, on ne tente plus de lui proposer du sport, du théâtre, un meilleur équilibre de vie… on lui prescrit un médicament. Le principe même des tests interdit, d’ailleurs, toute intervention éducative puisque tous les items sont négatifs et qu’aucune question ne peut permettre de repérer des points d’appui à une proposition d’activité…
En réalité, nous nous trouvons aujourd’hui dans une situation étrange et parfaitement cohérente à la fois : on laisse se développer, sous la pression d’intérêts économiques considérables et avec notre complicité, des machines à « détruire l’appareil psychique juvénile », comme le dit Bernard Stiegler, et, en même temps, on développe des dispositifs de contention pour limiter les dégâts sociaux de cette destruction. Il m’est arrivé de dire, et je ne le regrette pas même si cela peut paraître excessif, que notre société se résume à un slogan : liberté absolue pour les marchands d’excitants, répression totale pour les excités.
Nous perdons ainsi deux fois en matière éducative : en ne prenant pas en compte en amont les exigences du développement harmonieux de l’enfant et en ne cherchant pas comment rétablir pédagogiquement des équilibres qui ont été compromis. À cet égard, l’école maternelle représente un salutaire foyer de résistance. Et, plus que jamais, sur ce point, elle doit revendiquer son identité d’ « école première ».
-o0o-
L’école maternelle comme lieu privilégié d’articulation entre les apprentissages cognitifs et le « vivre ensemble »
S’il y a quelque chose que toute l’histoire de la pédagogie nous enseigne, de Pestalozzi à Montessori, de Kergomard à Froebel, de Decroly à Freinet, c’est qu’il n’y a pas d’apprentissages cognitifs sans rituels de vie collective. Et il faut entendre cette indissociabilité au sens fort : les rituels de vie collective ne sont pas simplement un habillage nécessaire, des conditions matérielles qui facilitent les choses, des concessions à la matérialité de notre condition humaine… ils sont consubstantiels aux apprentissages cognitifs et les structurent. J’ai moi-même beaucoup travaillé sur « le travail de groupe » et j’ai pu montrer qu’un groupe n’était pas seulement un moyen plus « sympathique » ou une facilité organisationnelle pour permettre d’acquérir des savoirs : la structure du groupe et de la communication détermine la nature des savoirs acquis, par le biais des « réseaux de communication » qu’elle instaure et des opérations mentales qu’ils permettent. On n’apprend pas la même chose en groupe qu’individuellement (si tant est que l’acquisiti
on individuelle ne soit pas une version intrapsychique d’interactions collectives) : le collectif structure les savoirs et, à l’école, les savoirs, donc, doivent être interrogés du point de vue du type de collectif qu’ils requièrent. La maternelle a, dans ce domaine, de belles longueurs d’avance sur le reste de notre école. Elle n’a pas à rougir de ses pratiques…
Ne nous laissons donc pas impressionner par les esprits forts qui viennent, ici ou là, nous dire que la maternelle, ça n’est plus que « le petit train pour aller faire pipi ». Ce mépris est insupportable ! Comme s’ils n’étaient jamais allés eux-mêmes faire pipi, et comme si cette dimension de l’enfance ne devait pas aussi être prise en compte ! Face à la méchanceté, soyons triviaux et rappelons aux grands universitaires qu’on apprend quand même beaucoup moins bien quand on a envie de pisser !
Ne nous laissons pas impressionner, non plus, par ceux qui croient – comble de l’idéalisme ! – qu’on peut laisser des coagulations d’élèves indifférenciés se précipiter, au rythme des sonneries stridentes, dans les couloirs des collèges… et leur demander, ensuite, de s’installer en quelques secondes à leurs bancs pour devenir miraculeusement disponibles à la raison qui s’expose. On ignore les règles élémentaires de gestion des groupes et l’on se plaint d’être vampirisé par des élèves qui exigent tous, individuellement, qu’on donne immédiatement satisfaction à leurs demandes. On s’épuise à demander le silence alors qu’on continue à parler sans attendre qu’il se fasse. On stigmatise des gêneurs qu’on ne cherche même pas à occuper par une activité mobilisatrice… Certes, il existe des situations-limites où l’action pédagogique est empêchée par des conditions sociales ou matérielles catastrophiques, mais, dans beaucoup de cas, on se contente de se plaindre de ne pas voir arriver ce qu’on n’a pas cherché à mettre en place ! Cette hypocrisie est insupportable : on ne réfléchit jamais aux rituels nécessaires pour apprendre, on s’exonère de toute réflexion sur l’organisation de l’espace et du temps, on fonctionne à l’exhortation – « Tenez vous tranquilles ! Écoutez-moi ! »… et l’on se plaint quand même d’avoir des problèmes d’autorité et des élèves insupportables ! On reproche à l’administration de ne pas faire son travail, aux parents d’être démissionnaires, mais on ne s’impose pas la moindre rigueur dans la mise en place des rituels d’apprentissage !
Car, la question de « la discipline scolaire » est bien souvent mal posée. Elle est coupée des objectifs de l’école et, en particulier, de ses objectifs d’apprentissage. On fait de l’école un lieu d’apprentissage du « vivre ensemble » indépendamment des activités d’apprentissage dans le domaine des savoirs. Certes, il y a bien une dimension sociale dans les règles de vie scolaire, mais je suis convaincu que, pour que les règles soient véritablement formatrices, elles doivent être référées à des exigences lisibles liées aux tâches scolaires, imposées elles-mêmes par les objectifs d’apprentissage que l’on se donne. Les rituels judiciaires, sportifs, religieux ne sont acceptés que parce qu’ils sont vécus comme intrinsèquement liés aux pratiques judiciaires, sportives, religieuses. C’est ce qui les rend légitimes. De même, à l’école, les disciplines qui disposent de « matériaux » structurants (comme les arts plastiques, la biologie ou l’éducation physique) sont bien plus à même de faire entendre la nécessité d’une « discipline de travail » que les matières qui n’ont aucune médiation matérielle pour venir lester l’activité du maître au milieu du déchaînement des pulsions des élèves.
À l’école maternelle, en revanche, vous connaissez les conditions de l’articulation optimale des apprentissages et du « vivre ensemble ». Vous savez que ce qui définit un rituel scolaire efficace, c’est qu’il est biface : il construit, dans le même mouvement, un savoir et un collectif. Ainsi, vous savez que l’écoute requiert un rituel : écouter, ce n’est pas seulement entendre, c’est mettre en œuvre une posture mentale particulière, adossée à une posture physique nécessaire, et qui permet de se mettre en situation de projection – nous disons de motivation expectative – vers une parole. Ainsi, quand vous lisez une histoire, vous travaillez simultanément sur l’intelligence de la situation pédagogique et sur l’intelligence de l’histoire, parce que vous savez que c’est bien la même intelligence qui est à l’oeuvre. De même, vous savez que l’usage des outils (du crayon au pinceau, de la blouse aux cubes…) est irréductiblement lié à la compréhension de ce qu’ils permettent de faire et d’apprendre. Un outil n’est pas choisi au hasard ni facilement remplaçable par un autre, il est en lui-même apprentissage et il faut l’introduire et le concevoir ainsi : le découvrir, le préparer, le ranger… tout cela est essentiel. Ce « matérialisme pédagogique », comme disait Célestin Freinet, est absolument essentiel. Vous l’avez découvert et mis en œuvre. Quel dommage que, parfois, votre travail ne soit pas prolongé ensuite !
Mais, bien évidemment, le « matérialisme pédagogique » ne signifie pas l’activisme. À cet égard, des chercheurs comme Élisabeth Bautier ont raison d’attirer notre attention sur les dangers de la dérive occupationnelle et de la multiplication d’activités de toutes sortes qui ne permettent pas d’effectuer des apprentissages significatifs, ou en limitent l’accès à certains élèves. La tradition pédagogique a, là encore, beaucoup à nous apprendre : rien n’est plus important que de distinguer la tâche de l’objectif, d’articuler ce qui relève de l’action immédiate et ce qui renvoie à des opérations mentales stabilisées. Les « pédagogies du projet » ne sont véritablement formatrices que si elles intègrent des moments structurés de formalisation… J’ai l’habitude, pour ma part, d’apprendre à faire distinguer systématiquement aux élèves ce qu’ils ont fait de ce qu’ils ont appris et de ce qu’ils peuvent réutiliser dans d’autres cas. Car, j’ai pu observer, dans mes travaux, que l’enfant sait, généralement, décrire ce qu’il a fait à l’école (à ses maîtres, à ses parents, à ses amis) ; en revanche, il parvient très mal à identifier ce qu’il a vraiment appris. Il sait très rarement expliquer ce qu’il a appris. Une recherche récente sur les activités théâtrales à l’école primaire m’a permis de bien repérer l’importance essentielle de la réflexion avec les élèves, dans des interrogations spécifi
ques et des temps particuliers, sur les acquis effectués ou engagés : c’est ce qui permet, par la mentalisation, une mobilisation déterminante sur les apprentissages et l’entrée dans la dynamique scolaire. Ce n’est pas simple parce que tous les enfants n’ont pas un accès identique au langage, ce n’est pas simple parce que la verbalisation est parfois difficile à mettre en œuvre… mais c’est essentiel.
Dans cette perspective, des chercheurs comme Mireille Brigaudiot insistent, à juste titre, sur un aspect déterminant de la pédagogie à l’école maternelle : il faut demander à l’enfant « ce qui se passe dans sa tête », l’amener à découvrir ce qu’il a compris en mettant en place des situations d’échange et de verbalisation, entre pairs, avec l’enseignant ou l’enseignante, avec les parents aussi. Vous savez, évidemment, que « savoir qu’on sait, c’est bien plus que savoir » et vous organisez des moments spécifiques pour faire découvrir cela à vos élèves : on peut dire, à cet égard, que vous êtes de bons spécialistes de l’évaluation ! Et que vous ne confondez pas la fonction pédagogique de l’évaluation – qui permet à chacun de progresser – avec la fonction sociale des tests et mesures de toutes sortes – qui permet à l’école d’effectuer la distillation fractionnée qu’on attend d’elle et de fournir aux parents, transformés en « consommateurs d’école », les indicateurs leur permettant d’optimiser leurs « stratégies scolaires ».
C’est pourquoi je crois si important que l’école maternelle soit reconnue comme « école première » : une école qui ne rabat pas ses ambitions sur le mesurable et le quantifiable, une école qui permet, en même temps d’apprendre et d’apprendre ensemble.
-o0o-
L’école maternelle comme cadre de l’émergence du sujet
L’émergence d’un sujet, cela ne va pas de soi. Le philosophe Emmanuel Lévinas parle, à ce sujet, d’une « pure éventualité ». Il souligne que « la dure loi des choses » c’est le « fermé sur soi », le repli dans son « être », l’affrontement avec les autres qui représentent toujours, plus ou moins, un danger, et, à terme, c’est le déchaînement de la violence sous toutes ses formes. On pourrait ajouter, dans une perspective plus pédagogique, que l’émergence d’un sujet, c’est « le moindre geste » d’une personne qui « se met en jeu », se dégage de l’immédiateté de ses pulsions, se démarque des étiquettes qui l’enferment dans une image, s’engage dans la temporalité d’une action qui l’amène à se construire, prend le risque d’apprentissages qui l’amènent vers de nouveaux horizons.
J’ai travaillé cette question depuis quelques années en croisant une approche de l’histoire de la pédagogie, des observations cliniques et une réflexion à caractère philosophique… Il faudrait être ici long et précis pour être complet, aussi je vais me contenter d’ouvrir quelques-unes des pistes parmi celles qui me semblent les plus importantes…
– D’abord, on permet à un sujet d’émerger parce qu’on aide un enfant à occuper une place sans prendre toute la place… Car, dans la fratrie comme dans la classe, celui qui occupe toute la place, c’est celui qui n’a pas de place. Si vous lui donnez une place, il n’occupera plus toute la place. Il ne sera plus le tyran, le vampire, celui qui veut absolument tout ramener à lui et imposer ses caprices en permanence… Il faut avoir une place pour ne pas occuper toute la place : il faut avoir un lieu d’où se déployer et où se replier, un rôle qui permette d’être reconnu et de ne pas avoir à tout casser pour exister aux yeux des autres. C’est affaire de dispositifs pédagogiques…
– Ensuite, on doit aider chacun à surseoir à ses impulsions. Il faut, en effet, surseoir au passage à l’acte pour entrer dans le désir. Le désir n’est pas la pulsion, car, si la réalisation de la pulsion abolit la pulsion, la réalisation du désir entretient et fait grandir le désir. Le désir se développe avec l’attente, suscite l’imagination, favorise la projection dans le futur. Le désir de savoir, par exemple, est extraordinaire car plus on sait, plus on désire savoir… Et le désir peut émerger, là encore, si vous mettez en place des dispositifs : « Tu pourras dire ce que tu penses et veux, mais pas tout de suite, tout à l’heure… Dans un cadre fait pour ça ! »
– Par ailleurs, pour favoriser l’émergence d’un sujet, on doit accompagner chaque élève vers la maîtrise de soi. Voilà aussi une perspective absolument décisive. Gabriel Madinier disait que l’éducation c’est « l’inversion de la dispersion »… Il me semble que cela est particulièrement d’actualité aujourd’hui. Il faut aider chaque enfant à accéder à ce moment où il sort de l’agitation, où il construit son l’intentionnalité, ce moment où le corps et l’esprit ne font qu’un et où toute l’intelligence passe dans le geste. C’est l’exigence du sportif qui serre une barre fixe, de l’artisan qui ajuste deux pièces de bois, du calligraphe qui trace une lettre au pinceau, du comédien qui salue de manière que l’universalité du salut passe dans une main qui se lève. Et, pour le pédagogue, c’est aussi une affaire de dispositifs : dispositifs pour prendre la parole comme pour apprendre à entrer dans le silence, dispositifs pour apprendre la lenteur et la concentration, dispositifs pour s’émerveiller doucement du monde qu’on découvre. Germaine Tortel a insisté merveilleusement sur cette formation de l’intériorité et a montré combien le dessin pouvait y contribuer. Son projet n’a rien d’obsolète, bien au contraire !
– Et, dans le prolongement de cela, on doit amener chaque enfant à intérioriser l’exigence de justesse, de précision et de vérité. Car il ne faut pas confondre le niveau d’excellence et le niveau taxonomique : on peut viser l’excellence à tous les niveaux de difficulté et à tous les échelons d’une progression. Un petit enfant qui apprend quelque chose de simple a le droit à accéder à l’excellence et nous devons lui permettre d’y arriver. Poser un caillou d’une certaine manière, faire un geste maîtrisé, exprimer un sentiment ou un point de vue, tout cela peut être occasion d’apprendre à entrer dans l’exigence de l’excellence. Et, dès la maternelle, c’est possible et nécessaire à travers une multitude de dispositifs pédagogiques. La maternelle est même un moment crucial pour engager cette dynamique, justement parce
qu’on peut y travailler sur des gestes « élémentaires » où l’enfant peut éprouver le bonheur d’un accord possible entre l’intention et l’acte.– Enfin – et c’est évidemment fondamental – on doit apprendre à chaque enfant à métaboliser ses pulsions. Car il y a, chez tout sujet, des pulsions archaïques dont nous savons, malheureusement, qu’aucun vernis de civilisation ne peut nous en protéger complètement. L’objectif de l’éducation, ce n’est donc pas de masquer ou de tenter de faire disparaître ces pulsions, c’est de les métaboliser. De les transformer en énergie créatrice… Pour cela, bien sûr, il nous faut offrir à l’enfant des médiations culturelles qui lui permettent de donner forme à ce qui l’habite, de symboliser ce qui l’inquiète ou le hante, ce qu’il espère ou désire… La littérature de jeunesse est un outil particulièrement précieux pour cela et je ne saurais trop vous dire à quel point je suis admiratif devant les créations françaises dans ce domaine : dès l’école maternelle, cette littérature doit avoir droit de cité dans la classe, elle doit être un outil pédagogique privilégié… Il faut raconter des histoires, il faut apprendre à regarder et à lire des albums, il faut parler des albums, il faut fabriquer des albums. J’étais, il y a quelques jours, dans une grande section de maternelle où les enfants fabriquaient des albums nouveaux avec tous les vieux albums cassés de ces dernières années : ils recollaient les pages autrement, découpaient les dessins et composaient de nouvelles histoires… Voilà une manière, parmi bien d’autres, de « faire récit », d’apprendre à donner sens aux choses dans la temporalité, de métaboliser ses pulsions, de reconstruire un monde pour mieux habiter ce monde.
Car l’enfant ne peut habiter ce monde que s’il parvient à lui « donner forme » par la culture, comme le dit si bien Jérôme Bruner. C’est pourquoi il faut lui raconter Le Petit Poucet : il y rencontrera des situations et des êtres qui vont lui permettre de relier ce qu’il a de plus intime avec ce qui est le plus universel. Il va découvrir qu’il n’est pas le seul à avoir peur d’être abandonné par ses parents et à être terrorisé par l’ogre… ce personnage étrange qui, à force de nous aimer, finit par nous manger. Il va, à travers un objet culturel, accéder à des interrogations anthropologiques fondamentales : comment aimer quelqu’un sans l’étouffer ? Comment être aimé de quelqu’un en conservant sa liberté ? Interrogations sans réponses, évidemment, mais interrogations essentielles qui le font accéder à « l’humaine condition »… C’est pourquoi, aussi, il faut, dès l’école maternelle, se mettre à l’écoute des réalités « scientifiques », observer le cycle de la nature et apprendre comment le respecter au mieux, interroger les phénomènes, émettre des hypothèses, en débattre… C’est pourquoi, également, il faut entrer dans une véritable démarche artistique, s’essayer à la création sous diverses formes…
Au bout du compte, avec la pédagogie que vous avez élaborée, avec les travaux que vous menez depuis des années, en vous nourrissant des résultats de la recherche, vous savez qu’on peut vraiment faire de l’école maternelle une « école première ». Une école où l’enfant peut émerger comme sujet. Parce qu’il peut prendre des risques sans se mettre en danger. Parce qu’il peut oser apprendre, créer, parler, imaginer, chercher à comprendre, interroger le monde et les autres. Et que rien n’est plus « premier » – primordial – que cela.
-o0o-
En conclusion, je voudrais, après avoir dit l’extraordinaire originalité et importance de l’école maternelle, souligner que, malheureusement, elle n’a pas, à elle toute seule, le pouvoir d’inverser la logique scolaire qui est en train de s’imposer aujourd’hui. Nous devons faire face, en effet, à la renonciation, plus ou moins avouée, aux principes fondateurs du service public. L’État ne garantit plus vraiment la qualité de ce service ; il se replie sur le financement d’un fonctionnement à l’économie ; il met les personnes, les établissements et les institutions en concurrence, en misant sur les vertus de la cette dernière pour pallier les effets de son désengagement. Parallèlement, il renforce son contrôle technocratique pour fournir des indicateurs de performance permettant de garantir la « transparence » et le « libre choix » des usagers. Dans cette perspective, il est normal qu’il s’attaque plus particulièrement à l’école maternelle : parce que cette dernière a des ambitions éducatives et qu’il veut se replier sur des apprentissages mécaniques… Parce qu’elle mise sur une éducation globale et qu’il cherche à promouvoir des savoir-faire standardisés… Parce qu’elle est rétive à l’évaluation strictement quantitative dont il veut faire un outil de pilotage universel… Parce qu’elle ambitionne de lutter au plus tôt contre les inégalités sociales dans un projet national et qu’il préfère, pour cela, s’en remettre aux collectivités territoriales et aux parents… Parce que la maternelle a expérimenté avec succès des méthodes pédagogiques inspirées de l’Éducation nouvelle et de l’Éducation populaire qu’il veut éradiquer… Parce que la maternelle représente le lieu par excellence de la prévention et qu’il a abandonné tout véritable projet dans ce domaine…
Mais, pour autant, nous ne sommes pas condamnés à l’esthétique de la désespérance. Vous l’avez montré dans votre congrès. Par la qualité de vos travaux et la détermination de vos engagements… La thématique même de cette rencontre, « Réussir, tous différents, tous ensemble », est au cœur d’un enjeu de société fondamental. Au fond, c’est la question même de la démocratie : comment vivre ensemble en respectant, à la fois, le droit à la différence et le droit à la ressemblance ? Comment articuler nos différences avec notre ressemblance fondatrice… et comment nous reconnaître fondamentalement égaux sans basculer dans une normalisation sclérosante ? Quiconque a assisté à ces journées sait que c’est possible. Dès la maternelle… Alors les enseignants et les enseignantes de l’école maternelle ne feront pas basculer les choses à eux tout seuls. Le combat pour la qualité de leur école doit s’inscrire, pour être efficace, dans des solidarités qui restent largement à créer… Mais, si vous ne prétendez pas avoir trouvé la voie, vous avez ouvert des voies. Et, contre tous les fatalismes et toutes les régressions, il faut oser dire que ces voies sont infiniment prometteuses. Y renoncer serait une démissi
on. Et je ne peux pas croire à la victoire de la démission éducative… à la défaite de l’éducation.
 SARTHE
SARTHE
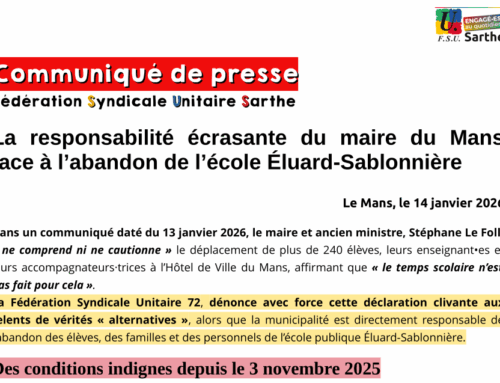
![Attaques au couteau : beaucoup de bruit, peu de moyens [mediapart]](https://fsu72.fsu.fr/wp-content/uploads/sites/39/2025/06/ARticle-mediapart-12-juin-2025-avec-titre-article-500x383.png)


