Ancien instituteur et formateur en IUFM, Bertrand Geay a mené parallèlement des recherches en sociologie de l’éducation. Il est aujourd’hui professeur à l’Université de Picardie. En 1999, il a publié Profession : instituteurs, un livre important sur un groupe social somme toute assez méconnu. Entretien avec un journaliste de Mediapart
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
C’est une annonce très curieuse puisque, d’une certaine manière, la suppression a déjà eu lieu avec l’intégration des IUFM dans les universités. Si l’on éprouve le besoin de l’annoncer, c’est sans doute qu’on va aller au-delà de cette intégration et jusqu’à la disparition de la formation professionnelle dans des écoles "professionnelles".
Cela conduirait vers une formation pédagogique de type universitaire avec quelques incursions sur le terrain sous forme de stages, un peu comme en Allemagne. Cette réforme est présentée de manière alléchante puisque la revalorisation à bac + 5, donc la « mastérisation » de la formation, est une revendication d’une partie des syndicats enseignants, du Snes notamment.
Mais le risque est de perdre tout le volet proprement professionnel de la formation. Cela risque d’instituer une césure entre la formation à l’université de l’enseignant et son adaptation sur le tas une fois recruté. On peut aussi imaginer que, même s’il est maintenu, le concours de recrutement ne soit plus indispensable pour enseigner. Ce concours pourrait à terme ne concerner qu’une minorité de la population enseignante. C’est la situation en Allemagne.
Les concours deviendraient des sortes de concours internes intervenant plus tard dans la carrière. C’est d’ailleurs ce qu’on est en train de mettre en place pour les chercheurs, auxquels on ajoute des années de post-doctorat ou de contrats de recherche, soit cinq ou dix ans de précarité. En réservant le statut à la part vieillissante du corps enseignant, on précarise les plus jeunes, les plus créatifs, les plus dynamiques, les plus revendicatifs aussi qui sont, du même coup, plus soumis, moins indépendants.
Cela dit, au regard de la baisse des effectifs étudiants, je ne vois pas très bien comment on va pouvoir recruter tous les enseignants à bac + 5. Et puis, si on le fait, on va encore réduire la part d’enseignants d’origine populaire.
Une double logique de rétrécissement
N’y a-t-il pas aussi le risque d’organiser une coupure encore plus grande entre enseignants du premier et du second degré ? En favorisant notamment le contenu disciplinaire au détriment de la partie pédagogique.
Il faudra attendre les traductions concrètes mais c’est très probable. Dans les IUFM, on a eu beaucoup de mal à créer une formation à peu près homogène pour le premier et le second degré. En fait, on a un peu déshabillé ceux qui se destinent au premier degré pour accoler des modules pédagogiques à ceux qui se destinent au second degré et qui, du fait de leur mode de recrutement et de l’organisation de leur formation, n’en voulaient pas.
On a détérioré la formation des uns sans améliorer celle des autres, et cela a souvent provoqué un rejet important de la formation chez les enseignants. Sans pour autant modifier les matrices professionnelles identitaires des corps du premier et du second degré. Il est donc fort probable que, sous la pression des corps d’inspection, des associations disciplinaires et de certains syndicats, on se retrouve avec des masters premier degré très pédagogiques et des masters second degré beaucoup plus centrés sur les disciplines.
Comment cette réforme de la formation des enseignants s’insère-t-elle, selon vous, dans le très vaste ensemble des réformes du système d’enseignement mises en œuvres par Nicolas Sarkozy, la réforme des programmes notamment ?
Il y a une double logique de rétrécissement. L’une joue sur les contenus et l’autre sur les corps enseignants. Dans les deux cas, il s’agit de réduire à la portion congrue. D’un côté, le savoir minimal enseigné et, de l’autre, la partie du corps protégé par le statut de la fonction publique.
Les nouveaux programmes du premier degré sont totalement désarticulés. Ils vont créer un grand désordre, avec des ajouts, des points lacunaires, des retours à des exercices classiques et, en même temps, l’ouverture à certains nouveaux domaines, le tout dans un volume horaire réduit et sans dispositif pédagogique amélioré de soutien pour les élèves en difficulté…
On met les enseignants face à une équation impossible à résoudre. Face à tant d’incohérence, que vont-ils faire? Que font-ils déjà ? La pente naturelle des enseignants du premier degré, qui sont un peu maîtres de leur savoir, est déjà d’élaguer dans certaines matières. Ces nouveaux programmes vont les conduire à le faire encore davantage.
Ils vont aller à l’essentiel et mettre de côté un certain nombre de savoirs universalistes un peu réflexifs qui demandent du temps dans l’apprentissage, tous ces savoirs qui nécessitent qu’on les découvre avant de les comprendre de façon un peu plus systématique. On se contentera du rabâchage de certaines notions et de savoirs utilitaires comme l’informatique ou l’anglais.
C’est une logique qu’on a déjà plus ou moins vu se mettre en place pour le secondaire lorsqu’on est passé de la commission Thélot à la loi Fillon, avec les préconisations européennes. On franchit désormais la même étape pour le primaire en désarticulant un corps de savoirs communs et universalistes au profit d’un enseignement minimaliste et directement utilitaire.
Des réformes qui ne répondent pas aux réelles carences
Cette logique de fond se double d’une autre qui concerne le statut des enseignants. Et là, le contexte général est celui du non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux. Cela n’a d’abord pas concerné les enseignants, mais on y vient doucement.
Cela risque donc de conduire au recrutement de personnels qui disposeraient d’une certaine qualification professionnelle mais qui ne seraient pas pour autant fonctionnaires et qui seraient mis à l’épreuve pendant un certain nombre d’années. C’est ce qu’on a vu se mettre en œuvre dans d’autres services publics.
Toutes ces mesures ne vont-elles pas contre ce qui apparaît pourtant comme des acquis des sciences de l’éducation ?
On a eu parfois tendance dans l’enseignement – et cela n’a rien à voir avec 68 ni avec la méthode globale et toutes les balivernes qu’on raconte à ce sujet – à perdre de vue les vertus pédagogiques de l’exercice, au profit de la découverte ou de la multiplicité des points de vue. On a eu tendance à oublier que la majorité des enfants ont besoin de découvrir une notion, un problème, une question mais aussi, ensuite, d’y revenir par la répétition, par la reformulation d’exercices.
Ce n’est certes pas par le rabâchage qu’on acquiert des notions mais par le retour vers elles à travers l’exercice… De nombreux chercheurs en sciences de l’éducation ou en sociologie ont écrit là-dessus. L’équipe autour de Bernard Lahire, par exemple, a montré comment on développe à l’école un certain type d’activité écrite qui présuppose des savoir-faire qui, dans certaines familles, n’ont pas été appris à la maison.
On connaît donc un certain nombre des carences de l’enseignement mais on sait aussi que pour y répondre il faut une bonne formation professionnelle des enseignants mais aussi du temps, le temps nécessaire à l’appropriation complète d’un certain nombre de notions. Ces réformes ne répondent pas du tout aux carences qui ont été mises en évidence. Il faudrait ainsi, par exemple, davantage de cohérence des programmes.
C’est un point qui fut soulevé dès la fin des années 80 par le rapport Bourdieu-Gros et sur lequel le Conseil national des programmes a travaillé pendant des années. Mais on est encore très loin aujourd’hui d’avoir construit des programmes qui permettent aux enseignants de mettre en œuvre des articulations raisonnées entre une discipline et une autre ou, de façon plus systématique, d’un niveau d’enseignement à un autre.
Il resterait beaucoup à faire mais c’est le contraire qui se profile, la seule cohérence consiste à mettre en œuvre un strict minimum vital de savoir parler et de savoir écrire rudimentaires, un peu de langue vivante, un peu d’informatique… Le reste sera abordé à l’école de façon un peu aléatoire, et surtout confié à l’extérieur.
Tensions exacerbées entre premier et second degré
Ces réformes ne traduisent-elles pas une forme de méfiance à l’égard de la pédagogie, souvent caricaturée en pédagogisme ?
Dans un fameux article publié dans les années 80, Viviane Isambert-Jamaty, qui est l’une des fondatrices de la sociologie de l’éducation, avait mis en évidence cette posture très ancienne dans le corps professoral et dans l’institution scolaire qui consiste à moquer les petits maîtres du primaire, ces « incapables prétentieux » et leur pédagogisme.
A partir de cette époque, avec les essais de Milner et autres, on a vu ce discours réapparaître puis progressivement se constituer en un fonds de commerce pour Finkielkraut et quelques autres. Certes beaucoup d’erreurs ont été commises dans les IUFM où l’on est parfois devenu maître en rhétorique, brassant beaucoup de concepts pour pas grand-chose. Il y a beaucoup à critiquer à propos des illusions de cette posture pédagogique qui ont été véhiculées dans ces institutions mais ce discours réactionnaire dépasse la critique raisonnée.
Car, sauf à estimer qu’enseigner c’est avoir la science infuse, on peut quand même admettre qu’une formation académique longue dans une discipline est certes indispensable mais loin d’être suffisante. L’accompagnement de l’entrée dans le métier est tout aussi important.
De ce point de vue, les IUFM ne furent pas une réussite : loin de créer une nouvelle culture enseignante commune mêlant des éléments de pédagogie du primaire, des savoirs didactiques du secondaire, et des savoirs universels du supérieur, on a exacerbé les tensions entre premier et second degré, entre profs agrégés et maîtres de conf…. Sans parler du mépris dans lequel les enseignants du supérieur tiennent souvent les IUFM.
Connaissant bien les deux univers, du primaire et du supérieur, j’ai toujours trouvé extrêmement pénible d’entendre ces discours de la part d’universitaires qui débarquent dans des amphis sans la moindre formation pédagogique.
On peut aussi avoir le sentiment que ce tournant réactionnaire et anti-pédagogique ne fut pas l’apanage des profs du supérieur, loin de là. Ces dernières années, on a vu fleurir les « essais » ou livres de témoignage d’enseignants du secondaire et du primaire… Certains de ces auteurs se retrouvant même aujourd’hui très proches du pouvoir.
Sur cette question, les choses sont en fait assez clivées dans le monde enseignant. Dans le premier degré, on a assisté à un tournant très pédagogique, un retour aux fondamentaux du syndicalisme enseignant de l’époque du SNI mais qui s’appuyait sur l’université et la recherche, ce qui était tout à fait nouveau par rapport à ce qu’avait été le syndicalisme enseignant.
Les Républicains réactionnaires risquent de déchanter
Dans le premier degré, on a donc donné la priorité à la recherche en éducation, à la pédagogie, beaucoup plus qu’à la réflexion sur les grands problèmes politiques de l’école. Ce qui peut se payer aujourd’hui en termes de conscience qu’ont ou n’ont pas les enseignants de ce qui se joue, et dans les découvertes un peu douloureuses qu’ils peuvent faire des réformes en cours.
Le secondaire a toujours été davantage tiraillé. D’un côté, sous les gouvernements de gauche, la sociologie de l’éducation a pu être un peu entendue, pour le meilleur et pour le pire, avec des pédagogues quasi officiels. D’un autre côté, on a le sentiment qu’aujourd’hui c’est bien la fraction la plus réactionnaire des Républicains qui a gagné la partie. Ceux qui sont pour le rétablissement de l’autorité, le respect dû au Père, les programmes à l’ancienne, la répétition…
Mais ces Républicains là font totalement l’impasse sur ce que fut la réflexion pédagogique des fondateurs de l’école publique. Quand on relit aujourd’hui ce qu’écrivait Ferdinand B
uisson et qu’on compare à Finkielkraut, on rigole !
On a effectivement assisté à une montée en puissance dans les cercles intellectuels de cette pensée réactionnaire qui ânonne et radote un peu. Le gouvernement de droite instrumentalise cette tendance pour, en fait, faire passer tout autre chose. Car loin de rétablir les humanités classiques et de cultiver l’héritage, il fait en réalité le contraire. Victorieux idéologiquement, le camp réactionnaire risque bien vite de déchanter.
 SARTHE
SARTHE
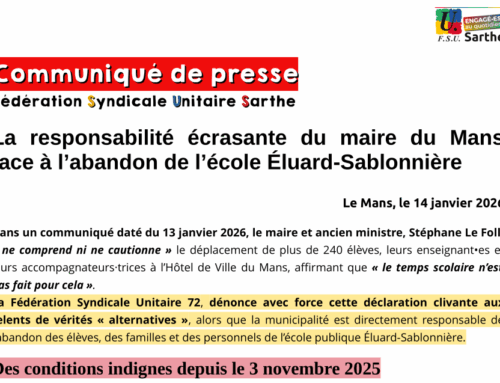
![Attaques au couteau : beaucoup de bruit, peu de moyens [mediapart]](https://fsu72.fsu.fr/wp-content/uploads/sites/39/2025/06/ARticle-mediapart-12-juin-2025-avec-titre-article-500x383.png)


