"L’identité nationale" remis à l’ordre du jour par E. Besson et N. Sarkozy s’inscrit dans la thématique de l’extrême droite. Thème historique et de prédilection de la droite pour nier la question sociale et museler les luttes ouvrières, cette phraséologie est dans la continuité de ce ministère de la honte "immigration et identité nationale". Il s’agit pour ce gouvernement d’insinuer sans le dire qu’entre les deux, il y a problème. Que l’un menace l’autre. Dans l’affrontement sans concession que nous devrons mener avec cette idéologie de la droite extrême, il est important de se doter des outils historiques et actuels indispensables pour lutter.
Comprendre pour agir.
Nous publions ici, une critique d’un livre de référence sur le sujet ainsi que deux entretiens avec l’auteur Gérard Noiriel.

L’article long en version pdf
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
Historien, directeur d’études à l’EHESS, membre du Comité de vigilance sur les usages de l’histoire (CVUH), Gérard Noiriel est membre démissionnaire du conseil scientifique de la Cité nationale de l’histoire de l’immigration.
L’ouvrage de l’historien Gérard Noiriel publié en 2007 editions Agone (Passé et Présent – 12€) est une véritable mise au point du concept d’« identité nationale », remise au goût du jour par Nicolas Sarkozy dans sa politique actuelle.
L’auteur, l’un des pionniers de l’histoire de l’immigration et de la formation de l’État-Nation, tente ici de donner quelques pistes pour nous éclairer sur l’évolution historique et sociologique de l’identité nationale.
La création d’un « ministère de l’Immigration et de l’identité nationale » a soulevé des polémiques, entraînant notamment la démission de huit historiens de la Cité nationale de l’histoire de l’immigration, dont Gérard Noiriel lui-même.
À travers une étude minutieuse, l’auteur nous livre ses doutes et ses craintes concernant l’instauration mais surtout l’appellation de cette institution, trop encline à conforter l’image et les préjugés négatifs liés à l’immigration. Basant son analyse sur un survol historique des différentes époques mettant en scène l’identité nationale, l’auteur nous rappelle les prémisses de la logique identitaire née au 19e siècle, dont certains aspects sont repris par les discours politiques d’aujourd’hui.
Synthèse de l’ouvrage par Julie Alev Dilmaç
Empruntant à Ricoeur ses concepts d’ipséité (correspondant à la conscience de soi, prenant place dans la continuité et la mémoire) et de mêmeté (la possession de caractéristiques propres aux membres d’une nation, leur permettant de se différer des autres nations), l’historien met en parallèle deux niveaux de compréhension de la « question nationale ». Le premier définit « le national » comme étant le peuple, synonyme, en 1789, de « tiers état ». Cette définition, née pendant la période révolutionnaire, reste au centre des conflits politiques jusqu’à la fin du 19e siècle, mettant en scène les monarchistes contre les républicains, fervents défenseurs de la nation. Le second niveau de compréhension s’inscrit dans les États allemands dans lesquels se développent les idées de Herder, Fichte et Jahn, donnant ainsi naissance au concept « d’identité nationale » (Volkstum). Ces militants révolutionnaires, en lutte contre l’aristocratie, le décrivent comme étant le « critère fondamental qui définit la nation, c’est l’étincelle de la vie, c’est-à-dire l’intelligence qui lui donne sa personnalité ». (p. 15). Ce terme sera, par la suite, repris en France sous la forme de « nationalité ».
L’implication des historiens dans l’illustration concrète de ce terme est indéniable : ce sont eux qui, à travers la sélection de récits nationaux illustrés par des événements épiques vont contribuer à l’imposition des grandes figures nationales, renforçant ainsi le « principe de nationalité ».
La distinction des dualités, à savoir qui sont les « étrangers », qui sont « ceux qui posent problème », semble être le fil conducteur de l’analyse de Noiriel. Ainsi, on cerne qu’au 19e siècle, le discours sécuritaire et le discours national n’étaient pas entremêlés, comme ils le sont aujourd’hui. Seules les « classes laborieuses » étaient considérées comme dangereuses.
L’histoire des identités nationales va prendre de l’importance dans toute l’Europe avec la guerre de 1870, date à laquelle l’État-Nation se développe. L’ampleur de ce tournant fondamental est expliqué par l’auteur comme le renforcement des dualités entre la nationalité qui forme le « nous » et celle des autres. Dans la même optique, les définitions de la nation en France comme en Allemagne renforcent leurs significations, notamment avec la fameuse conférence de Renan donnée à la Sorbonne en 1882, qui combine à la fois « sentiment de la patrie » et « volonté de vivre ensemble ».
À la même époque, de nombreux changements institutionnels se mettent en place, en vue de la démocratisation de la vie politique. Le concept de citoyenneté, et par extension, celui de fidélité à l’État, émergent, définissant ainsi l’attachement aux lois élaborées par ces mêmes individus et la défense de leurs institutions.
Ce concept de citoyenneté se voit renforcé avec l’adoption en 1889 de la première loi sur la nationalité française et avec le droit de vote octroyé à tous les hommes français adultes. La nationalité devient un enjeu capital, redéfinie comme appartenance à l’État, loyauté à la communauté et mobilisation en temps de guerre.
Le paroxysme de la ferveur patriotique est atteint lors de la 3e République. Les symboles de la nation deviennent visibles sur tous les fronts : représentation de la France sur les cartes géographiques, imposition de héros nationaux par l’École de Jules Ferry ; la Marseillaise devient l’hymne national et le 14 juillet, une fête nationale. Tous ces éléments renforcent les consciences et l’identification des individus à leur nation.
Or, l’auteur distingue de manière flagrante à travers les exemples de Barrès et de Jaurès, les diverses conceptions qu’a pu prendre l’identité nationale. Ainsi, face aux menaces de l’Allemagne, la France se devait de ressouder la population de son pays. Définir au plus vite l’identité nationale était donc vital. Barrès propose deux voies pour renforcer le sentiment national : ce que Noiriel nomme la « haine du voisin » ainsi que la référence au passé à travers les commémorations afin de souder les vivants aux morts. L’identité nationale se résume donc au rejet de l’étranger « qui n’aime pas la France ». Cette haine prend forme dans les préjugés raciaux qui sont au fondement de l’œuvre de Barrès.
Jaurès, quant à lui, préfère parler de « patriotisme », renvoyant à ceux qui aiment la France. Cependant, la question nationale n’est en aucun cas le pilier de son programme politique : il préfère la subordonner à la question sociale. Pour lui, il est indispensable de lutter par une révolution pacifique contre les injustices économiques provenant de l’exploitation patronale des ouvriers. Ainsi, il cherche à concilier, tout en plaidant pour la paix, la défense de l’intérêt national avec les idéaux universalistes du mouvement ouvrier.
Avec la défaite de juin 1940, l’État crée le premier organisme chargé de la question identitaire. Or, après la seconde guerre mondiale, suite à l’internationalisation des échanges entraînant la diversification des affiliations identitaires tournées vers la consommation, l’obsolescence des références à la nation se fait sentir.
Les événements de Mai 68 mettant au premier plan les revendications de divers groupes jusque-là stigmatisés (le féminisme, le mouvement ouvrier, le régionalisme, l’antiracisme…) vont permettre l’introduction de l’expression « identité nationale » dans le vocabulaire politique français. Celle-ci est ensuite reprise dans les années 1980, par le Front national qui véhicule un discours dénonçant le « communautarisme » islamiste. L’auteur nous montre ici comment, par la logique sécuritaire et la désignation de l’ennemi (ou plutôt l’étranger) tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, les politiques ont tenté, notamment celle de Jean Marie Le Pen, de renforcer le « nous » identitaire. Ces discours abondamment relayés par les médias ont permis aussi de conforter le « nous » de l’audimat. Les sujets pouvant contribuer à l’illustration de ces idées pullulent alors, s’étendant sur trois niveaux récurrents : la guerre au Moyen Orient, le terrorisme islamiste et la délinquance des jeunes des banlieues.
À travers une étude minutieuse des discours de Nicolas Sarkozy lors de son élection présidentielle, Noiriel nous montre comment ce dernier crée un nouveau nationalisme en combinant les définitions de Barrès et de Jaurès. La forme de la menace prend alors la figure du « clandestin », celui qui refuse de parler la langue nationale, qui ne respecte pas les lois de la République, celui qui endosse tous les éléments relevant du communautarisme (liés notamment aux origines ethniques et à la religion).
De la sorte, l’auteur démontre la pratique de démarcation de l’identité nationale par son contraire, forgeant ainsi la distinction classique du « nous » et du « eux ». Mais Noiriel n’en reste pas là et s’insurge contre la création du « ministère de l’immigration et de l’identité nationale » qui ne contribue qu’à perpétuer « l’association “ immigration et identité nationale ” dorénavant inscrite dans la loi […] devenue une catégorie de pensée et d’action qui s’impose à tous, quelque soit l’actualité du jour » (p. 146).
En comparaison de cette forme de nationalisme, l’auteur reprend les propos de la gauche, ceux de Ségolène Royal en particulier, montrant que celle-ci renforce son discours dans la lignée de Jaurès, c’est-à-dire en privilégiant le patriotisme au nationalisme.
Noiriel finit par rappeler que la question de l’identité nationale ne concerne pas seulement les Français, et qu’il est important de ne pas omettre que les populations se définissent les unes par rapport aux autres et que dans ce contexte, il est primordial de cerner l’importance des dégâts causés par les stéréotypes repris par les politiques.
Cet ouvrage engagé intègre approche historique et sociologie. Il est une synthèse intéressante mettant en perspective les propos des politiques à la lumière des sujets d’actualités.
Entretien avec Gérad Noirel – "L’identité nationale" en France
Historien, directeur d’études à l’EHESS, auteur d’une vingtaine d’ouvrages, Gérard Noiriel, spécialiste de l’histoire du monde ouvrier, des intellectuels et de l’immigration, est aussi un intellectuel engagé. Président du CVUH (Comité de vigilance sur les usages de l’histoire), il est aussi l’un des membres démissionnaires du Conseil scientifique de la Cité nationale de l’histoire de l’immigration. Gérard Mauger l’a interrogé sur les controverses d’hier et d’aujourd’hui, nouées autour de la thématique de « l’identité nationale ».
Gérard
Mauger : Peut-être peut-on commencer cet entretien en évoquant « l’identité nationale » et ses usages ? C’est à peu près le titre de ton dernier ouvrage…
Gérard Noiriel : Dans ce livre, je prends d’abord les mots au sérieux. C’est-à-dire les mots « identité » et « nationale » accolés. Si on fait cette analyse, on s’aperçoit qu’en fait la notion est récente dans le vocabulaire français. On peut dire qu’elle commence à circuler dans les années 1970. C’est une francisation de « national identity » qui existe aux États-Unis depuis les années 1950. En anglais, en américain plutôt, c’était au départ une notion empruntée au vocabulaire des sciences sociales ou plutôt une notion de la psychologie sociale de l’intégration des immigrés. Éric Erickson et d’autres ont beaucoup travaillé sur l’identité, notamment celle des enfants ou des adolescents. Mais, à l’époque, dans les années 1950, les universitaires progressistes étaient pour l’assimilation. La tendance se retourne dans les années 1960, où on a justement la montée en force des identités, des revendications communautaires, etc.
Et ce phénomène s’observe également en France. Nicolas Sarkozy a dénoncé en bloc la pensée de 1968, mais, en fait, « l’identité nationale », en est un produit. Au début, la notion d’identité est mobilisée par des régionalistes. Bourdieu a fait un article très connu sur le sujet où il remettait tout cela en cause… « Les régions » sont présentées comme des « nations » opprimées par des militants qui dénoncent l’impérialisme de l’identité dominante pour revendiquer le fait d’être corse ou occitan comme une « identité nationale ». Au cours des années 1980, il y a un retournement avec le Front national qui va imposer l’expression dans le vocabulaire courant. C’est à partir de ce moment que la droite et l’extrême-droite récupèrent la notion. Si on s’écarte un peu des mots précis, on peut remonter, bien sûr, beaucoup plus haut dans le temps. Avant on parlait plutôt « d’âme » ou de « caractère national »… Mais, on peut montrer qu’il y a des invariants dans tout le discours nationaliste. Quand il est mis en circulation par la droite et l’extrême-droite, ce discours est toujours lié au vocabulaire sécuritaire, c’est-à-dire au vocabulaire de la menace. Barrès est typique de ce point de vue : il s’agit de présenter l’étranger comme danger vital pour la nation. Il y a donc une connotation qui n’est d’ailleurs pas présente dans tous les pays… Mais, en France, l’identité nationale, c’est extrêmement connoté.
Gérard Mauger : Tu veux dire qu’en France le discours sur l’identité nationale est un attribut distinctif de la droite ?
Gérard Noiriel : Oui et on peut le mesurer très précisément. Je pense que c’est une réponse que la droite a apportée à la politisation de l’identité ouvrière. C’est très précisément au moment de la création du Parti ouvrier français de Jules Guesde, au moment donc où naît le premier parti marxiste, et aussi l’anarchisme, que l’on voit une alliance se créer entre l’ancienne droite des notables monarchistes ou bonapartistes, qui se rallie alors à la république, et une nouvelle droite venue du camp républicain (c’est-à-dire de l’ancienne gauche). La défense de « l’identité nationale » est le thème qui permet de souder l’alliance entre ces deux fractions de la classe dominante. C’est vraiment très clair. Comme je l’ai souligné dans un livre précédent, c’est à ce moment-là que le clivage « droite-gauche » se structure autour du clivage « classe et nation ». On voit naître une opposition entre un pôle « national- sécuritaire » et un pôle « social-humanitaire ». Nous en sommes toujours tributaires, même si l’antagonisme s’est beaucoup atténué depuis 20 ans. Les problèmes posés au moment de la dernière campagne électorale , notamment la difficulté de la gauche à se définir par rapport à la question nationale, s’expliquent par cette bi-polarisation initiale. Dans ce petit livre sur l’identité nationale, j’ai analysé les discours de Nicolas Sarkozy et de Ségolène Royal. On s’aperçoit très vite que c’est lui qui a été à l’offensive sur la question nationale. C’est le terrain, j’allais dire le jardin, de la droite. C’est pourquoi, pour le camp conservateur, l’un des enjeux majeurs de la dernière campagne électorale était d’imposer ce thème comme un thème central du débat politique. Tous les grands moyens d’information sont venus à la rescousse de Nicolas Sarkozy pour faire croire aux électeurs qu’il y avait là une question vitale pour l’avenir de la France. Seule l’extrême gauche (et les Verts) a pu récuser ce « problème » car la gauche de gouvernement, qui espérait gagner les élections, était obligée de se situer par rapport aux questionnements imposés par les dominants. La même logique était déjà à l’œuvre avant 1914. L’extrême gauche anarcho-syndicaliste ou marxiste dénonçait déjà le discours national, mais la gauche socialiste était contrainte d’affronter la droite sur son terrain de prédilection. C’est ce qu’a tenté de faire Jaurès avec sa redéfinition du « patriotisme ». Ce qui est frappant sur la longue durée, c’est que nous ne sommes toujours pas sortis de cette matrice. Aujourd’hui, évidemment, il n’y a plus le mouvement ouvrier et toutes les forces sociales qui le soutenaient. Mais, malgré tout, le clivage entre le « national » d’un côté, et le « social », de l’autre, reste structurant.
Gérard Mauger : Mais tu évoquais aussi la mise en avant par les « post-soixante-huitards » des « identités régionales ». Dans le même ordre d’idées, on pourrait évoquer aussi, parallèlement au déclin du marxisme, la promotion à la même époque de tous les clivages « perpendiculaires » aux clivages de classes : hommes/femmes, jeunes/vieux, homosexuels/ hétérosexuels, etc.
Gérard Noiriel : On observe, en effet, une mise en concurrence des bonnes causes. On l’a vu au moment du voile islamique. Au nom du féminisme, on va stigmatiser les musulmans. C’est effectivement lié à la marginalisation du critère social qui joue à tous les niveaux. L’ethnicisation du discours social à laquelle on assiste aujourd’hui offre à la droite de nombreuses possibilités pour renforcer son hégémonie. Nicolas Sarkozy a d’abord tenté de jouer sur la corde communautaire (cf. la campagne autour du « préfet musulman » quand il était ministre de l’Intérieur). Mais à partir de 2006, il a changé son fusil d’épaule. Pour récupérer l’électorat lepéniste, il a délibérément repris à son compte le discours sur l’identité nationale stigmatisant les «
communautaristes musulmans ». L’annonce de la création du ministère de l’Immigration et de l’Identité nationale, lui a fait gagner 4 à 5 points dans les sondages et ces points ont été pris au FN.
Gérard Mauger : Pourrais-tu expliciter le rapport qu’on peut établir entre la création de ce ministère, la notion d’identité nationale et le vote Le Pen ?
Gérard Noiriel : « L’identité nationale », c’est une expression qui est de plus en plus utilisée par les historiens dans une perspective critique et en termes « d’usages » : on étudie les usages que les différents groupes d’acteurs ont pu faire de l’identité nationale pour défendre leurs intérêts ou légitimer leur pouvoir. Mais, dans le champ politique français, le rapprochement des deux notions, « immigration » et « identité nationale », a toujours été porteur d’un discours négatif sur l’immigration. Cela, on peut le démontrer par a plus b. Depuis que ce ministère a été créé, en mai 2007, il a été constamment entraîné dans la fuite en avant. Elle est inéluctable dans ces configurations-là. Le discours national-sécuritaire présente le moindre fait divers impliquant des étrangers comme une « menace » pour l’identité nationale. C’est donc un problème qui ne peut jamais être résolu. Les dirigeants d’un tel ministère doivent, par conséquent, donner constamment des gages à « l’opinion » pour montrer qu’ils « luttent » contre la « menace », car ils sont sous la pression de l’extrême droite qui utilise les mêmes faits divers pour dénoncer leur « laxisme ». Le débat sur l’ADN doit être en partie situé dans cette perspective. Le problème c’est de savoir comment on peut répondre à ce type de politique. Je pense qu’aujourd’hui, les conseillers en communication intègrent dans leur stratégie les protestations des militants associatifs ou des intellectuels de gauche… On constate que la mobilisation contre l’amendement sur les tests ADN, si l’on en croit les sondages, n’a pas permis de diminuer le nombre de ceux qui était « pour », mais qu’elle a abouti au résultat inverse. La protestation basée sur la rhétorique classique des droits de l’Homme amplifie donc aujourd’hui les effets de ce nouveau nationalisme. C’est assez désespérant, mais c’est comme ça. La politique, c’est toujours un rapport de forces. Et notre rôle, à nous sociologues, c’est de dire les choses telles qu’elles sont, pas telles qu’on voudrait qu’elles soient. Nicolas Sarkozy a poussé cette logique à son paroxysme, mais elle existe ailleurs qu’en France. C’est une tendance générale. Pour résumer, on peut dire qu’en rapprochant « immigration » et « identité nationale », la droite a trouvé un thème qui a permis d’évacuer la question sociale. On a vu qu’entre les deux tours des législatives, dès que le débat a été focalisé sur la taxe sociale, la droite a reculé. C’est quand même assez fascinant de voir comment cela fonctionne ! Et nous qui étions engagés dans la création de la Cité de l’immigration, nous ne pouvions pas rester les bras croisés…
Gérard Mauger : Peut-être pourrais-tu justement parler de l’expérience de la Cité nationale de l’histoire de l’immigration et de ce qui vous a amenés à démissionner ?
Gérard Noiriel : Depuis le début de mes recherches, je me suis investi dans des projets culturels, à dimension civique, tout en distinguant soigneusement ce qui relevait de la recherche scientifique et de l’action militante. C’est une expérience que j’avais faite d’abord à Longwy. On avait fondé une association qui regroupait des militants ouvriers et des enseignants, autour de la défense du patrimoine sidérurgique. C’est la création de Radio Lorraine Cœur d’Acier qui a donné une dimension exceptionnelle à cette volonté de prise de parole de la part des ouvriers locaux. Cette expérience m’a marqué. C’est ce qui m’a amené à plaider pour l’ouverture d’un « lieu de mémoire » dédié à l’immigration, notamment dans mon livre Le Creuset français – publié en pleine période du bicentenaire de la Révolution française. Nous avons alors créé une association réunissant des universitaires spécialistes de cette question en dépassant les querelles de boutique.
J’avais pu observer, dans la génération qui a précédé la nôtre les ravages causés par le narcissisme et l’individualisme universitaires. Les historiennes et les historiens de l’immigration ont réussi à préserver une démarche collective qui explique l’impact qu’a eue notre démission du conseil scientifique de la Cité nationale de l’histoire de l’immigration (CNHI). Ce geste a rencontré de l’écho parce que nous avons été huit à démissionner. Un seul l’aurait fait, cela n’aurait pas eu d’impact. L’écho qu’a rencontré dans les médias notre protestation prouve que le monde savant possède, aujourd’hui encore, une petite légitimité dans l’espace public, ce qui permet de faire un peu bouger les lignes. Mais si l’on est tout seul, c’est voué à l’échec. Il faut donc savoir agir collectivement. Ce qui m’avait impressionné dans les années 1980 avec les médecins, c’est leur capacité à intervenir collectivement pour casser net le discours de Le Pen et du Front national sur « les immigrés qui seraient responsables du sida ». Dans les années 1930, les médecins avaient massivement relayé ce genre de choses et cela avait été très important dans le développement du racisme. Là, on voyait des médecins, incontestables sur le plan scientifique, qui étaient capables de se mobiliser publiquement pour combattre la xénophobie. Je ne dis pas que, dans les sciences sociales, on peut arriver au même résultat, mais, malgré tout, je pense qu’il y a des possibilités. Donc, l’idée d’un lieu culturel qui ferait passer les résultats de la recherche et qui fonctionnerait un peu comme une université populaire, je l’avais à cœur et j’ai tout fait pour la promouvoir. Mais le projet a végété pendant très longtemps. Il paraissait évident que c’était la gauche qui devait le faire. Mais elle n’a pas réussi à l’imposer et c’est finalement la droite qui l’a mis en œuvre. Au bout du compte, ce qui a été déterminant, c’est la présence de Le Pen au second tour des présidentielles. Jacques Toubon, qui a été chargé par Jean-Pierre Raffarin de piloter le projet, n’a jamais mis en cause l’autonomie du conseil scientifique de la CNHI. C’est la raison pour laquelle nous avons pu travailler ensemble. En novembre 2005, lorsque Nicolas Sarkozy a dénoncé publiquement la « racaille », les historiens du conseil scientifique ont publié un texte collectif dans Le Monde pour déplorer ce langage et rappeler que les dirigeants des partis politiques n’étaient pas dispensés d’éducation civique. La création du ministère de l’Im
migration et de l’Identité nationale a marqué un tournant. Nous ne pouvions pas cautionner un ministère dont l’intitulé était en contradiction avec la principale mission de la CNHI, à savoir « Changer le regard sur l’immigration ». Avec l’intitulé du ministère Hortefeux, il y a une contradiction ! Lors de l’ouverture, qui n’a pas été une inauguration, on a bien senti que cette institution n’était pas vraiment soutenue en très haut lieu. Les historiens de l’immigration refusent le discours actuellement dominant qui vise à opposer l’immigration passée (qui aurait réussi à s’intégrer en respectant les valeurs de la république), et celle d’aujourd’hui qui poserait problème. La contradiction est là : entre des usages opposés du passé de l’immigration…
Gérard Mauger : Quels ont été, selon toi, les effets de mai 1968 sur l’évolution des discours antiracistes ?
Gérard Noiriel : Dans l’ouvrage sur la responsabilité des élites en matière de racisme, je parle un peu de ces questions. Il existe effectivement des tendances qui s’inscrivent dans le prolongement de ce qui s’est passé après 1968. Là aussi, il faudrait faire des études plus approfondies car on manque de travaux là-dessus. Mais on peut dire que, globalement, le discours antiraciste tel qu’il est aujourd’hui commence à s’élaborer dans les années 1950. Il n’est plus adapté pour comprendre les réalités d’aujourd’hui. C’est ce qui explique les divisions que l’on constate, par exemple sur la question des statistiques ethniques. Contrairement à ce qui est souvent affirmé actuellement, je ne pense pas que la question des races ait été absente du débat public dans le passé. Au contraire, c’est un thème qui a toujours été omniprésent. Le discours racial revient en force aujourd’hui parce qu’il est porté par un certain nombre de forces, notamment l’industrie du spectacle qui vise le marché mondial et qui a donc besoin de fabriquer des représentations de la société extrêmement simplifiées, à l’aide de signes immédiatement visibles et compréhensibles par le « grand public » international. En même temps, le discours sur les « minorités visibles » peut être facilement politisé. Le fait de nommer un(e) ministre « d’origine immigrée » peut ainsi être présenté comme une preuve du combat contre les injustices sociales et contre les discriminations. Du coup les inégalités sociales passent à la trappe.
Gérard Mauger : Peut-être la promotion de ce genre de thématique correspond-elle aussi à des stratégies au sein du champ scientifique ?
Gérard Noiriel : C’est sûr. Il y a en France une tendance à dire que nous sommes « en retard » sur les États-Unis parce que nous n’avons pas pris au sérieux la question raciale. Par ailleurs, l’importance que les journalistes accordent à ces questions et la nécessité pour les jeunes chercheurs d’aller vers des thèmes qui paraissent « neufs » jouent aussi un rôle. Il faut aussi tenir compte de l’émergence d’une petite élite issue de l’immigration dont les membres proviennent des classes populaires, mais qui en sont coupées aujourd’hui parce qu’ils ont changé de milieu. Ceux-là sont très souvent incités à exalter ce qu’ils perçoivent comme un point commun avec les membres de leur ancien milieu à savoir l’origine ethnique, la couleur de peau, la religion, etc. Ils ont tendance à occulter la dimension sociale pour se constituer en porte-parole d’une communauté mythique.
Gérard Mauger : C’est ainsi qu’est apparue la controverse « question raciale/question sociale » ? Mais comment créditer d’un sens sociologique la variable « raciale » ? Soit elle renvoie à la stigmatisation, aux discriminations, c’est à- dire, en définitive, au racisme, soit elle est associée à une culture « ethnique » supposée…
Gérard Noiriel : Dans le courant qui dénonce la color blindness, beaucoup disent que « la race, cela n’existe pas », mais qu’elle fonctionne néanmoins comme une catégorie discriminatoire. Le discours sur les « discriminations » repose en grande partie sur ce genre d’arguments. Pour ces auteurs, les immigrés issus de l’ancien empire colonial seraient discriminés en raison de la couleur de leur peau, de leur patronyme, etc. Les mécanismes d’exclusion du marché du travail sont ainsi ramenés à des problèmes de perception de l’autre, des préjugés. Cela permet, comme on le voit de façon caricaturale dans le documentaire de Yamina Benguigui, « le plafond de verre », aux « bons patrons » de se donner le beau rôle, en montrant tous les efforts qu’ils font pour combattre les « préjugés » (car les racistes ce sont toujours les autres). Ce type de discours aboutit finalement au constat, alimenté par les enquêtes d’opinion réalisées par des organismes comme la Commission consultative des droits de l’homme, que plus on est pauvre, plus on est raciste. La question de la domination est rabattue sur un problème de bonne éducation. C’est l’éternel retour de l’ethnocentrisme des élites. Les conséquences politiques de ce genre d’analyse sont désastreuses. Les Français qui ne sont pas issus de l’immigration et qui sont confrontés au chômage ou au déclassement ne peuvent pas se « reconnaître » dans ces propos sur les discriminations. C’est l’une des raisons qui expliquent à mon sens l’impact du discours de Le Pen, et aujourd’hui de Sarkozy, dénonçant le racisme antifrançais. La critique principale que je fais à cette approche, c’est que, dans la réalité, les critères isolés n’existent pas, ils sont toujours associés à d’autres. Le critère de classe se conjugue toujours avec d’autres. Zidane est un enfant d’immigré qui est devenu la personnalité préférée des Français. Du coup, les journalistes ne lui ont jamais demandé s’il était pour ou contre la guerre en Irak.
Gérard Mauger : Une fraction des intellectuels juifs a joué un rôle important, me semble-t-il, dans le revival de la problématique identitaire ?
Gérard Noiriel : La revendication identitaire a ressurgi à partir des années 1970 chez les personnes dont les parents ont disparu avec la Shoah. Alors que la génération précédente avait eu tendance à privilégier une démarche universaliste, la guerre au Moyen-Orient a radicalisé les positions. Dans mon dernier livre, j’ai insisté sur l’ampleur de l’antisémitisme en France, pour souligner que ses formes actuelles n’ont plus grand-chose à voir avec celles du passé. C’est la même chose dans le cas du « racisme ». On ne peut pas mettre tout sur le même plan. Ce revival identitaire contribue à l’atomisation des luttes parce que chacun défend son pré carré. C’est au
ssi pour cela que nous avons créé le CVUH.
Gérard Mauger : Tu pourrais peut-être dire un mot du CVUH ?
Gérard Noiriel : La création de ce comité était, pour moi, une manière de concrétiser les propositions que j’avais faites dans mon livre sur les intellectuels. Lancé peu de temps avant le vote de la fameuse loi de février 2005 sur les aspects « positifs » de la colonisation, le CVUH a élargi rapidement son action à d’autres enjeux de mémoire. Nous avons ainsi été amenés à défendre notre collègue Olivier Pétré-Grenouilleau, menacé d’un procès en justice à la suite de son bouquin sur la traite négrière, par un groupe parlant au nom des Noirs de France. Nous avons créé le comité pour défendre l’autonomie de la recherche historique, contre toutes les pressions politiques, médiatiques ou autres. C’est à ce moment-là que nous avons lancé la pétition contre la loi du 23 février 2005, qui a été relayée tardivement par les politiques. Nous avons obtenu en partie gain de cause, puisque l’article 4 de cette loi a été finalement « déclassé ». La grande place accordée par Nicolas Sarkozy à l’histoire de France, dans sa campagne électorale, a multiplié les fronts de lutte pour le CVUH. Nous sommes reconnus désormais comme des interlocuteurs légitimes y compris par les journalistes de la presse du soir. L’affaire Guy Môquet nous a permis de développer nos liens avec les enseignants du secondaire. Ce sont de petites choses. Néanmoins, on contribue ainsi à pérenniser les postures de résistance, à un moment où elles tendent à s’affaiblir, y compris chez les universitaires.
Gérard Mauger : Vous avez eu un débat sur les statistiques ethniques ?
Gérard Noiriel : Il y a actuellement deux pétitions en cours de signature. L’une demande davantage de statistiques ethniques, l’autre n’en veut pas. J’ai des amis des deux côtés. On ne peut pas dire que l’une est de droite, l’autre de gauche. Ce que je reproche aux uns et aux autres, c’est de prendre les choses par le petit bout de la lorgnette. Les statistiques, c’est une façon de classer le monde social. Avant cela, il y a le langage, il y a l’ensemble des discours publics. Cela, on n’en parle jamais qu’évidemment les intellectuels n’aiment pas parler de leur propre pouvoir. Il me semble qu’il faudrait essayer de trouver un espace de réflexion pour nous interroger de façon plus fondamentale sur le passage du discours privé au discours public. Ce que je critique dans ces pétitions, c’est aussi la logique d’expertise. Ce ne sont pas des questionnements autonomes. La question est en train de rebondir via un des amendements de la loi Hortefeux sur l’immigration, avec l’aval de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL. Je crains fort que ces statistiques et ces enquêtes aboutissent finalement à renforcer l’ethnicisation du discours social, en déréalisant encore un peu plus les formes de domination qui règnent aujourd’hui dans la société française.
Propos recueillis par Gérard Mauger Revue Savoir/Agir n°2, décembre 2007
Interview de Gérad Noiriel (juin 2009)
La question de l’identité nationale a été remise au centre de l’actualité politique française par Nicolas Sarkozy. Entretien avec l’historien Gérard Noiriel, sur la logique identitaire et ce que l’histoire nous apprend de son utilisation par le politique.
« A quoi sert l’identité nationale » est le titre d’un de vos livres. Comment définiriez-vous l’identité nationale ?
Gérard Noiriel : En fait, il n’existe aucune définition scientifique du concept d’identité nationale. D’ailleurs, à chaque fois que des chercheurs en sciences sociales ont tenté de lui apporter une définition, leurs travaux ont été récupérés politiquement, surtout par les nationalistes. Ces chercheurs s’intéressent en revanche aux usages qui sont faits de ce concept. Le vocabulaire qui circule dans l’espace public n’est jamais neutre. En France, c’est le Front National qui a mis en circulation l’idée d’identité nationale. Depuis la fin du XIXe siècle, la vie politique française se structure d’ailleurs autour du combat entre une droite qui met en avant l’identité nationale et une gauche qui met en avant, peut-être moins maintenant, l’identité sociale.
Quelle différence faites-vous entre l’identité nationale et la nationalité ?
G.N. : Le mot « nationalité » est né, en France, dans les années 1830. Il avait un sens proche de ce qu’entendent ceux qui parlent d’identité nationale, c’est-à-dire le sentiment d’appartenance à une nation. La première loi sur la nationalité date de 1889, ce qui est assez récent. Jusqu’à cette époque, on ne savait pas toujours qui était français, qui ne l’était pas. Le droit actuel de la nationalité est une conséquence de la citoyenneté républicaine. La République a introduit une logique d’égalité/identité où les gouvernants sont légitimés à diriger l’État parce qu’ils sont de la même essence que les gouvernés. Désormais, pour représenter le peuple, il faut être du peuple. Cette démocratisation de l’accès à la politique (1) et l’adoption de lois sociales réservées aux Français ont conféré un enjeu politique au fait d’être français. Cette mécanique républicaine va conduire à la volonté d’unifier le peuple par une langue commune (2), une culture commune, etc. Mais cette « identité » ne date que de la IIIe République.
L’identité nationale a-t-elle toujours été liée à la question d’immigration ?
G.N. : Une identité se construit toujours par opposition à d’autres. C’est le « nous » face au « eux ». L’historien Jules Michelet disait déjà que la France a pris conscience d’elle-même en combattant les Anglais. Mais Michelet avait une vision révolutionnaire de la nation. Il pensait que la France était la patrie de l’universel. C’est en s’ouvrant de plus en plus sur l’extérieur qu’elle pouvait rester elle-même. À la fin du XIXe siècle, c’est une définition conservatrice de l’identité nationale qui
s’impose.
Même si beaucoup l’ont oublié, l’utilisation de l’identité nationale par la droite est ancienne. En proposant la création d’un ministère de l’identité nationale, Nicolas Sarkozy a simplement réactivé le débat pour permettre le déplacement des voix du Front National, indispensables à son élection. Ça a parfaitement fonctionné (3).
Finalement, la création de ce ministère change-t-elle quoi que ce soit ?
G.N. : Quand vous créez une structure administrative, elle ne peut pas rester une coquille vide. Il faut la remplir. Jusqu’à présent, ce ministère a surtout été un ministère de l’intégration et de la chasse aux immigrés, plutôt que de l’identité nationale. Cela risque de changer, comme le laisse supposer le projet de musée de l’histoire de France. Créer un ministère, c’est installer les choses dans la durée ; lier immigration et identité nationale, dans l’intitulé d’un ministère c’est ancrer dans le cerveau des gens le préjugé qu’il y a un lien entre les deux. Ce qui est faux historiquement et dangereux politiquement.
Comment la mondialisation interfère-t-elle avec la question de l’identité nationale ?
G.N. : La « mondialisation » n’est que la poursuite d’un processus aussi vieux que l’humanité, à savoir l’extension des chaînes d’interdépendance entre les individus. Les tensions entre les logiques politiques qui s’inscrivent dans un cadre étatique et les logiques de marché qui, elles, sont mondialisées, ont toutefois tendance à s’accroître. Les États en sont affectés, des pans de l’économie sont détruits… Tout cela engendre des replis identitaires, la montée de l’hostilité.
Le monde est en crise. Certains craignent une nouvelle crise de 1929 et le retour des nationalismes. Partagez-vous cette analyse ?
G.N. : Cette crise ne se pose pas du tout dans les mêmes termes. Dans les années 30, le nationalisme avait d’abord été financier. La dévaluation du dollar et de la livre sterling était une forme de protectionnisme. Aujourd’hui, il existe des systèmes de concertation beaucoup plus élaborés qui viennent atténuer les effets de la crise. Les gens eux-mêmes voyagent davantage et sont donc plus internationalisés. Je ne pense pas que le nationalisme puisse redevenir ce qu’il a été dans le passé. Le contexte a changé.
Il est plus judicieux de mobiliser l’histoire pour comprendre et prévenir les mécanismes qui produisent le nationalisme. Dans les pays en voie de développement, les situations de misère sont telles que le nationalisme peut trouver la base sociale qu’il n’a plus en Europe. Le Traité de Versailles a été l’une des causes de la Seconde guerre mondiale : les conditions inacceptables qu’il a imposées à la population allemande l’ont plongée dans une détresse dont s’est nourri le nationalisme. Nous n’en sommes pas là mais c’est pour cette raison que les pays développés ont intérêt à se solidariser des plus démunis et à ne pas leur faire payer la crise.
1. En France, les hommes ont le droit de vote depuis 1848.
2. En 1870, la moitié des Français parlaient des langues locales et des patois. Ils ne parlaient pas le français de Paris.
3. D’après un sondage, 88 % des électeurs du Front National approuvaient la proposition de créer un ministère qui lie identité nationale et immigration.
Propos recueillis par David Eloy juin 2009, Altermondes n°18
 SARTHE
SARTHE
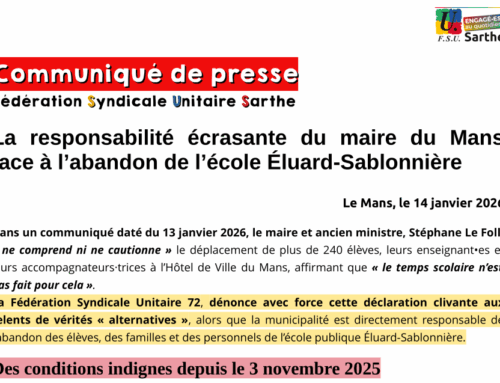
![Attaques au couteau : beaucoup de bruit, peu de moyens [mediapart]](https://fsu72.fsu.fr/wp-content/uploads/sites/39/2025/06/ARticle-mediapart-12-juin-2025-avec-titre-article-500x383.png)


