Le besoin d’une élévation très significative de la formation et de la qualification des jeunes générations s’est fait ressentir, dans les différents pays capitalistes développés, dès les années 1950. La réponse qui lui a été apportée en France apparaît, avec le recul, particulièrement paradoxale.
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
La Troisième République scolarisait séparément les enfants du peuple (voués à l’enseignement primaire) et ceux de l’élite (accueillis dans les lycées). L’« école unique » mise en place entre 1959 (avec le décret Berthoin qui porte la scolarité obligatoire à 16 ans et permettra la généralisation de l’entrée au collège) et 1975 (réforme Haby instaurant le collège unique) se proclame ouverte à tous, et récuse ostensiblement toute détermination des parcours scolaires par l’argent ou la position sociale. Ce discours sera rapidement et massivement entendu : entre 1963 et 1972, avant même donc l’émergence du chômage de masse, la proportion de parents ouvriers souhaitant que leurs enfants obtiennent au moins un bac passe de 15% à 62%.
D’un autre côté, les mécanismes de régulation des flux scolaires propres à l’école unique, conjuguant l’évaluation continue des élèves, leur classement et leur orientation dans un dispositif de sections et de filières hiérarchisées, vont se révéler redoutablement efficaces. Les nouveaux publics du secondaire seront en effet assez systématiquement orientés vers les nouvelles filières (moins valorisées) de l’enseignement professionnel et technologique. Au point qu’après quatre décennies, et alors même que l’école unique a permis une explosion des scolarités unique dans l’histoire, l’inégalité sociale des chances scolaires n’a pas bougé d’un pouce. Ainsi dans les années 1960 les chances d’obtention d’un bac général étaient de 56 % pour un enfant de cadre et 11% pour un enfant d’ouvrier (45 points de différence) ; ces chances sont aujourd’hui respectivement de 72 et 22% (50 points de différence).
On a là les ingrédients qui font de la question scolaire depuis quatre décennies une question « chaude », et qui le reste, le poids du diplôme sur le marché du travail et la hantise du chômage ne faisant rien pour atténuer son acuité. Malgré l’échec des politiques successives de lutte contre l’échec scolaire, et la réticence persistante d’une majorité d’enseignants face au principe du collège unique, la revendication populaire d’une meilleure efficacité de la transmission scolaire reste très forte et empêche tout abandon du dossier de la démocratisation de l’école.
Une perspective réaliste ?
N’est-il pas cependant quelque peu illusoire, comme on l’entend parfois soutenir à gauche [1], de prétendre changer l’école sans changer la société ? Outre le caractère réversible de cette proposition (comment changer la société sans changer l’école ?), il y a toutefois bien des raisons de ne pas réduire les inégalités scolaires à une traduction mécanique des inégalités sociales et culturelles. L’enquête PISA de l’OCDE menée dans 43 pays différents met en évidence une efficacité variable de l’école : les parcours scolaires peuvent accentuer les inégalités sociales ou, à l’inverse, les traduire de façon plutôt atténuée (comparée aux pays scandinaves, la France dispose à cet égard d’une marge de progression très confortable).
L’examen des processus en jeu conforte, quant à lui, le principe d’une relative indépendance entre action scolaire et structures sociales. Les recherches sociologiques et sociolinguistiques accumulées depuis les années 1960 ont confirmé la variation selon l’origine sociale des ressources langagières et culturelles des différents publics scolaires. Mais si ces travaux prouvent l’avantage relatif dont disposent les enfants de parents longuement scolarisés, ils ne disent rien quant aux capacités des autres. Que ces derniers soient moins avantagés n’implique en rien qu’ils n’ont pas les ressources nécessaires à une entrée satisfaisante dans la culture écrite, même si elle est moins facile ou moins brillante. Et de fait, l’examen des performances intellectuelles dans les cultures orales, ou de celles des enfants d’avant l’entrée au CP, montre que l’entrée dans le langage assure par elle-même, quelle que soit les modalités culturelles de son usage, la formation des capacités à l’abstraction et au raisonnement logique qui suffisent à une scolarisation normalement réussie.
La fameuse théorie du « handicap socioculturel » ne saurait rendre compte, autrement dit, de l’échec massif aujourd’hui des jeunes d’origine populaire. L’action scolaire peut bénéficier même à ceux qui ne disposent au départ que du parler populaire des cités. Et l’on ne saurait davantage imputer leurs difficultés d’apprentissage à une absence de « motivation » : toutes les enquêtes montrent que le désamour du travail intellectuel et des savoirs de l’école n’est pas la source, mais la conséquence de difficultés scolaires précoces vécues comme insurmontables.
Démocratiser l’école paraît donc un objectif tout à fait réaliste. Et même urgent, à mesurer les dégâts sociaux provoqués par l’échec de masse. Mais comment s’y prendre ? La question appelle quelques observations préalables.
Un objectif très ambitieux
Face à la posture normative qui domine aujourd’hui les débats (telle pédagogie est la plus conforme aux besoins des enfants, au fonctionnement de l’esprit humain, etc.), il importe sans doute d’adopter une approche critique, qui s’efforce par l’examen attentif des pratiques d’identifier les obstacles à la démocratisation ; et qui n’hésite à prendre acte des limites des façons actuelles de procéder, fussent-elles parfaitement séduisantes sur le papier, et à en tirer les conséquences.
Depuis la mise en place de l’école unique et la modernisation pédagogique qui l’a accompagnée, une théorie de réformes partielles, une accumulation de mesures de remédiation et de discrimination positive ont cherché à réduire l’
échec scolaire. Elles n’ont pas eu d’effets sensibles sur le rendement pédagogique du système. Une telle expérience, réitérée pendant près de quatre décennies, invite à beaucoup d’audace et de radicalité intellectuelles : la démocratisation scolaire est au prix, d’évidence, d’un retour sur les principes même qui organisent aujourd’hui les fonctionnements de l’école.
La revendication syndicale d’une amélioration massive du financement public de l’école, posée comme condition de sa démocratisation, apparaît totalement légitime : pour remplir leur mission de façon efficace, les enseignants (et les élèves) ont besoin de bonnes conditions de travail. Mais la question subsiste de ce que l’on fait des moyens dont on dispose. Ainsi du taux d’encadrement : le meilleur imaginable, celui qu’assurent les cours particuliers, est loin de toujours donner des résultats spectaculaires. Les 3000 postes arrachés par la lutte de masse au ministre Allègre en 1998 en Seine-Saint-Denis n’ont pas réduit l’échec scolaire dans le département. Et le dédoublement des effectifs en classe de CP, expérimenté sur une centaine de sites par le ministre Lang, n’a produit aucun résultat significatif. En matière de démocratisation, on ne peut contourner la question de la transformation des pratiques.
Vouloir une école démocratique apparaît ainsi comme un objectif à la fois réaliste et très difficile à réaliser. Socialement, le maintien des choses en l’état peut faire l’objet d’un consensus tacite entre les classes dominantes et les classes moyennes, qui tirent plus ou moins leur épingle du jeu. Même si elles représentent près des deux tiers de la population active, les classes populaires qui auraient, elles, intérêt à changer les règles du jeu, se sentent beaucoup moins autorisées à intervenir. Il est frappant, à cet égard, de constater que les syndicats de salariés (et les partis de gauche) ont largement délégué aux organisations enseignantes le soin de définir ce qu’il convient de revendiquer en ce domaine. Politiquement, les choses ne sont pas plus simples. L’école unique a été vécue comme une façon même imparfaite de réaliser le plan Langevin-Wallon de 1946 ; la rénovation pédagogique des années 1960/70 a été appréciée et soutenue dans son principe par les syndicats enseignants et les organisations progressistes. Suggérer aujourd’hui aux partisans de la démocratisation scolaire que celle-ci passe par un réexamen critique de ce dans quoi ils ont investi si fortement ne manque jamais de provoquer chez eux de vives crispations.
De l’école unique à l’école commune
L’école unique implique la prise en charge de la sélection sociale par l’institution scolaire. Ce n’est pas une école égalitaire mais une école de l’égalité des chances. Et pour donner à chacun sa chance, elle organise la mise en compétition permanente des élèves, au moyen de procédures d’évaluation à l’œuvre désormais dès la petite section de maternelle. L’école unique, c’est la sélection : ce principe qui dès l’origine a structuré sa conception (ce n’est pas parce qu’on ouvre le collège, notait Berthoin dans les attendus du décret de 1959, qu’on va accepter au lycée des milliers de jeunes qui n’ont rien à y faire), a deux conséquences anti-démocratiques.
Quand une institution qui doit répartir des flux dans un dispositif de filières inégalement valorisées accueille des individus disposant de ressources inégales et les met en concurrence, il est inévitable que les moins dotés soient assignés au pôle des perdants, et vice-versa. La concurrence transmue la différence des ressources en échec des uns et réussite des autres, elle transforme en échec de masse des différences langagières et culturelles qui n’ont par elles-mêmes rien de rédhibitoire.
Dans un contexte concurrentiel il est tout aussi inévitable, d’autre part, que les ressources de l’institution soient elles-mêmes distribuées inégalement, et affectées au prorata de la puissance sociale des bénéficiaires. C’est ce qu’atteste une grande variété d’enquêtes : la règle la plus générale de l’institution scolaire est de donner moins à ceux qui ont moins. Cette règle s’applique à la distribution des savoirs essentiels (les difficultés d’apprentissage dans les matières fondamentales de la culture écrite orientent vers des sections et des filières où leur apprentissage est allégé, alors qu’un souci démocratique conduirait à un renforcement de l’enseignement). Elle s’applique à la répartition des moyens financiers (dont les établissements les plus populaires sont les moins dotés) ; à celle des moyens humains (les classes les plus difficiles sont assurées par les enseignants les moins expérimentés) ; à la gestion des parcours des élèves (à valeur scolaire égale, l’affectation au redoublement, à l’enseignement spécialisé, aux classes de faible niveau, aux filières dévalorisés s’effectuent toujours au détriment des élèves d’origine populaire) ; à la distribution des ressources pédagogiques (face aux élèves d’origine populaire et aux classes difficiles, les enseignants ont majoritairement tendance à limiter leurs ambitions intellectuelles).
On doit admettre, dès lors, que la suppression radicale de la concurrence entre les élèves est la première condition, sine qua non, de toute entreprise de démocratisation scolaire. Sa réalisation implique la mise en place d’un véritable tronc commun jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire (et porter celle-ci à 18 ans prendrait acte de la situation actuelle). Elle implique aussi la suppression de toutes les remédiations pénalisantes (redoublement, enseignement spécialisé, classes de niveau, filières) au profit de soutiens ponctuels dans telle ou telle matière. Les enseignants débarrassés des tâches de sélection seraient ainsi rendus à leur véritable mission de transmission des connaissances, et les jeunes pourraient apprendre autrement que sous pression permanente. Ce passage à une véritable école commune impliquerait d’évidence une rupture avec les modèles culturels que nous avons profondément intégrés depuis deux ou trois générations. Mais, après tout, les systèmes scolaires relativement performants de Norvège ou de Finlande ont bien réussi à mettre en place un tronc commun de ce type, sans redoublements ni filières.
Du côté des contenus et des pratiques d’enseignement
L’instauration d’une école commune en France pa
sse d’évidence par un remaniement d’ensemble des contenus et des pratiques d’enseignement. Dans une telle perspective, un recours historiquement inédit à l’action démocratique s’imposerait à deux égards.
Puisqu’elle concerne tout un chacun, la définition des contenus de l’enseignement commun, de la culture commune autrement dit qu’il convient de transmettre aux jeunes générations, mériterait le plus large débat public.
L’école commune n’est pas concevable, par ailleurs, sans une forte amélioration de l’efficacité démocratique des pratiques enseignantes. C’est là une seconde grande condition de la démocratisation scolaire, qui ne saurait être réalisée sans que les enseignants se réapproprient, dans leur masse, la maîtrise des gestes du métier. Les dispositifs de scolarisation qui pilotent à distance leur activité dans les classes, définissant les pédagogies légitimes, ont toujours été conçus, depuis la loi Guizot de 1833, par des experts extérieurs qui s’embarrassent peu de retours d’expérience. Or l’amélioration du rendement de l’action pédagogique ne peut passer à l’inverse que par une autogestion instruite et collectivement maîtrisée de l’activité enseignante. Seuls en effet des enseignants bien formés et capables de dialoguer sur un pied d’égalité avec les chercheurs, mus par l’intérêt du métier et donc par le désir de la réussite des élèves, sont en position d’expérimenter, d’identifier et d’intégrer en savoir faire professionnels les façons d’apprendre les plus performantes.
Le prix de la démocratisation de l’école, qui implique au bout du compte une refonte d’ensemble des structures scolaires comme des façons d’enseigner, peut paraître particulièrement élevé. Les échecs des dernières décennies donnent peu de crédibilité, en ce domaine aussi, aux voies courtes [2].
[1] Par exemple, pour le plus récent, par Pierre Bergounioux, Ecole : mission accomplie, Les Prairies ordinaires, Paris, 2006.
[2] Les enquêtes et données utilisées dans cet article, ainsi que les propositions qu’il avance, sont exposées et développées in Jean-Pierre Terrail, De l’inégalité scolaire, La Dispute, Paris, 2002 ; et Jean-Pierre Terrail (dir.), L’école en France, La Dispute, Paris, 2005.
 SARTHE
SARTHE
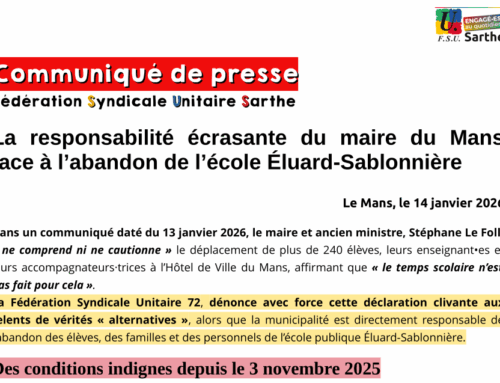
![Attaques au couteau : beaucoup de bruit, peu de moyens [mediapart]](https://fsu72.fsu.fr/wp-content/uploads/sites/39/2025/06/ARticle-mediapart-12-juin-2025-avec-titre-article-500x383.png)


